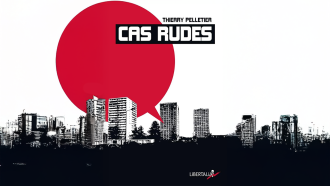
Tout commence à la fin des années 1980. L’Angleterre traverse une grave crise sociale et économique, et vit, depuis 1979, sous le joug conservateur de la « Dame de fer », Margaret Thatcher. Cheffe de file d’un parti raciste, homophobe et mysogine, aucun aspect de la société n’est épargné par ses lois répressives. Et certainement pas la fête. En 1987, alors que la techno, l’acid house et autres musiques électroniques commencent leur ascension, la Première ministre britannique décide d’interdire les « rassemblements nocturnes » au-delà de 2 heures du matin. C’est sans compter sur une jeunesse avide de fête, de musique, de danse, de communion et, surtout, de liberté. Dès les premières semaines, les usines et hangars désaffectés du pays se transforment en clubs à ciel ouvert et marquent le début d’un mouvement qui deviendra planétaire : la teuf.
Rave on
La recette est simple : des enceintes empilées, capables de cracher du son à pleine balle, détenues par des collectifs qui organisent de plus en plus de soirées auxquelles on donnera le nom emblématique de « raves » et dont les informations, tenues secrètes jusqu’au dernier moment, circulent sur des flyers, passés de main en main. Le jour venu, ce sont dorénavant des centaines, voire des milliers, de personnes qui se retrouvent pour danser et défier un système qui va à l’encontre des valeurs de liberté et d’inclusion prônées par les teufeurs.
Mais cette nouvelle mode n’est pas du goût du gouvernement britannique, et de Margaret Thatcher, qui veut mettre fin à cette nouvelle fête libre, symbole d’émancipation d’une jeunesse en rupture avec sa vision conservatrice de la société. Elle aggrave alors, en 1990, les sanctions contre les organisateur·ices d’évènements festifs non autorisés à 20 000 livres d’amende et six mois de prison.
En avant la révolution
La fin d’une nouvelle ère ? Pas du tout. La réponse des organisateur·ices ne se fait pas attendre : c’est la naissance des « free parties », des fêtes libres, dans lesquelles on « pose » du son, souvent en milieu rural, dans ce qu’on appelait alors des « Temporary Autonomous Zones » (zones autonomes temporaires), et dont l’entrée se fait à prix libre. Inspirés des sound systems jamaïcains, apparus dans le pays dans les années 1940, les premiers sound systems européens, collectifs détenteurs de matos de sonorisation et organisateur·ices de soirées, voient alors le jour. Parmi eux, les emblématiques Spiral Tribe. Collectif créé en 1990, proches des travellers New Age dont iels adoptent le mode de vie, iels sillonnent les routes en camtar et organisent la plupart des premières free anglaises. « Forward the Revolution » (en avant la révolution), scandaient-iels pendant leurs teufs.
John Major, le successeur de Margaret Thatcher, prépare une loi, qui sera votée en 1994, punissant de trois mois de prisons les participant·es à des rassemblements de plus de dix personnes « sur fond de musique répétitive ». Très médiatisé·es, et fortement réprimé·es, les Spiral Tribe et un certain nombre de sound systems décident de quitter le Royaume-Uni pour des terres (à l’époque) plus clémentes. C’est alors qu’en 1993, iels gagnent le territoire français pour y diffuser la bonne parole de la teuf. Le 23 juillet de la même année aura lieu le premier teknival français près de Beauvais, fruit de la collaboration de plusieurs sound systems.
Rapidement, le mouvement trouve un vaste écho auprès du public et prend de l’ampleur en France où les free et autres teknivals se multiplient et attirent parfois jusqu’à plusieurs milliers de personnes. En 1995, le ministère de l’Intérieur diffuse la circulaire Pasqua intitulée « Les soirées raves : des situations à haut risque » à tous les préfets, services de police et de gendarmerie du pays et déploie un arsenal répressif à l’égard d’un mouvement naissant mais déjà profondément stigmatisé.
Car dès son apparition, c’est tout le système politico-médiatique qui décide, à l’unisson, de diaboliser les organisateur·ices et le public de la free. Drogué·es, toxicomanes, marginaux·ales… iels deviennent les symboles de tout ce que la société d’alors (et d’aujourd’hui) considère comme des maux, et ne seront jamais considéré·es comme ce qu’iels sont : des libres penseur·euses, des militant·es politiques, des radicaux·ales.
Car la free est festive mais elle est aussi et surtout politique. Libertaire, autogérée, c’est également l’un des berceaux de la réduction des risques… Rendez-vous le 14 juillet pour notre prochain épisode.







