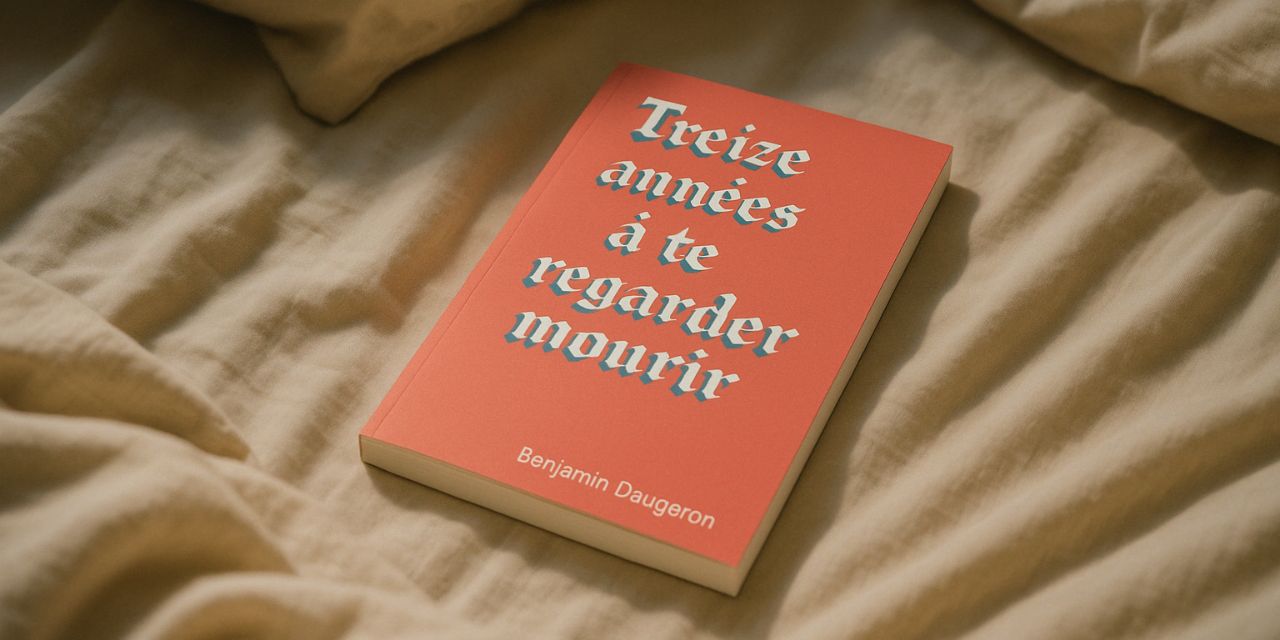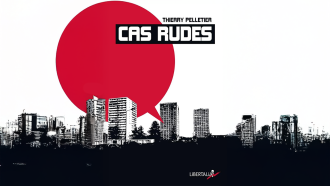Benjamin Daugeron publie un premier livre désarmant et révoltant. Un texte court et percutant où chaque mot semble à sa place, quand on le referme, on a la sensation que tout a été dit.
3 Infos à retenir :
📖 Un récit familial percutant et court
-
-
-
Benjamin Daugeron publie Treize années à te regarder mourir, un livre de 78 pages retraçant l’histoire de 4 générations dans le Berrichon, marquées par l’alcoolisme et les rapports de domination sociale et de genre.
-
Le texte est concerné et resserré, chaque mot étant au service du récit familial et du deuil de son père.
-
-
🍷 L’alcool comme héritage et mécanisme de survie
-
-
-
L’alcool est présenté comme un moyen de fuir la réalité et la fatalité sociale pour plusieurs générations.
-
Il provoque dépendance, cercles vicieux et violences dans les familles, affectant hommes et femmes différemment, notamment dans un milieu rural isolé et marqué par des normes virilistes.
-
-
⚖️ Un texte engagé et dénonciateur
-
-
-
Le livre rend hommage aux victimes de l’abandon systémique et de l’inaction des autorités sanitaires, dénonçant la négligence sociale et médicale envers les populations marginalisées.
-
Il interroge le déterminisme social et ses conséquences sur la violence familiale et l’alcoolisme, tout en partageant la peine et la honte vécues par les familles concernées.
-
-
En moins d’une centaine de pages, l’auteur retrace en vérité l’histoire de 4 générations. De Solange (l’arrière–grand-mère) à Colette (la grand-mère) puis André (le père) jusqu’à lui, dans le pays Berrichon. Des destins marqués par la vie dans les classes laborieuses. Soumis à des rapports de dominations (de classe sociale notamment, mais aussi de genre) et donc, bercés d’alcool. Un travail d’investigation de l’auteur dans sa généalogie pour comprendre ce qui l’a mené à perdre son père – prématurément.
« Ça allait mal pour la famille Daugeron. Daniel, le père d’André était malade de l’alcool comme ses frères et sœurs. Et comme ses parents, ses oncles, ses tantes et peut-être même ses grands-parents avant lui. Un alcoolisme qui n’était pas le fruit d’une tradition ou d’une culture mais qui était déjà le témoin à l’époque d’un renoncement à l’avenir de toute une catégorie de population abandonnée, laissée à elle-même. L’alcool était un moyen de sortir du réel, d’accepter le poids de l’existence, sa fatalité. »
Si on devait tracer un parallèle avec un auteur récent qui a travaillé sur ces thématiques–là, on penserait évidemment à Édouard Louis, best-seller en librairies depuis 2014. Un autre auteur ouvertement homosexuel plaçant son héritage familial – sans fiction – au cœur de son œuvre, ainsi que transfuge de classe. Mais le jeu des ressemblances entre les écrivains s’arrête ici, tant l’écriture de Daugeron est resserrée autour de son sujet : l’alcoolisme de son père (et ses aïeux). Jetez un œil à notre critique du dernier livre d’Edouard Louis qui traite justement de l’alcool dans la famille et de deuil.
BOIRE POUR S’OUBLIER
Boire pour oublier, c’est une chose. On le sait, les vertus anxiolytiques de l’alcool ne sont plus à démontrer mais à long terme, il peut entraîner une forte dépendance avec risques de dépression et de troubles anxieux qu’on est ensuite tenté de faire taire avec davantage d’alcool. Un cercle vicieux. Grandir dans ce genre d’ambiance est un défi qu’il faut relever et dont on ne sort pas indemne. Personnellement, j’ai pleuré deux fois à la lecture de ce court ouvrage. Le texte parle de ces hommes élevés dans un dogme viriliste. Qui les éloigne de facto du soin (un garçon ça ne pleure pas, un garçon ne demande pas d’aide, un garçon n’a pas mal, un garçon doit garder la tête haute, etc.). Qui plus est dans le désert médical généralisé que représente la diagonale du vide.
Les violences sexuelles ne sont jamais loin quand l’alcool est dans la partie, l’occasion de revenir sur la vie toute particulière des femmes dans un milieu rural à l’époque où les gens étaient très sédentaires, religieux et isolés.
Invité à une séance de dédicaces par les libraires indépendants de l’histoire de l’œil à Marseille, l’auteur a expliqué sa démarche de manière tout à fait éclairante : il s’agissait en somme de rendre une forme d’hommage – tout en dénonçant les affres de milliers de personnes abandonnées à leur sort par les autorités sanitaires –, ainsi que de partager la peine et la honte. Il indiquait notamment pouvoir nommer de tête au moins 5 hommes de sa jeunesse qui n’ont pas atteint les quarante ans – à cause de l’alcool.
« André n’est pas le seul à la ZUP à ne pas dépasser la quarantaine. Ces gens-là, les ivrognes, les alcoolos, on ne les compte plus, on ne les voit pas. L’État s’en fout. André n’est pas encore mort que déjà il n’existe plus. »
Un abandon généralisé, systémique, pourrait-on dire. Il racontait aussi la honte vécue. Comment le corps de son père, « malade de l’alcool », était perçu par les autres. Il décrit les regards, les grimaces, les mots qui abîment. Que ce soit son regard ou celui des autres dans les transports en commun de la capitale lors d’une visite de son père.
« À travers le parcours de son père, Benjamin Daugeron raconte ici l’histoire d’une emprise, l’alcool, et interroge les mécanismes d’un certain déterminisme social et de ce qu’il produit de violence au sein d’une famille. »
Treize années à te regarder mourir est le premier roman de Benjamin Daugeron. Paru dans la Collection des réels aux Éditions du Commun fin 2024, il compte 78 pages (format Livre de poche) et coûte 12 €. On vous en recommande vivement la lecture et si vous trouvez ça trop cher, n’hésitez pas à en suggérer l’achat à votre bibliothèque de proximité.
Cette maison d’édition publie des textes (prose, poésie et essais) engagés depuis dix ans et on est heureux de pouvoir les mettre en avant.