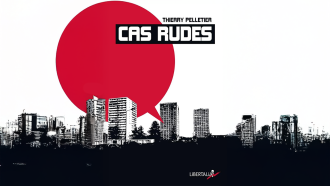
Penser l’accessibilité ?
À l’occasion de la Journée mondiale du handicap, KEPS vous propose une série d’articles sur la fête et l’accessibilité. L’occasion de faire le point sur l’inclusivité de nos espaces festifs, sur nos angles morts, sur nos comportements validistes, mais surtout, de donner la parole aux personnes concernées : « Rien sur nous sans nous ».
Le handicap existe : il est présent, visible ou invisible, dans une société pensée par et pour les personnes valides.
Il est temps de pousser notre réflexion plus loin : sur nos comportements, nos exclusions involontaires, et sur les choix que nous laissons, ou refusons, aux personnes en situation de handicap. Soins, communautés, plaisirs : les personnes handicapées ont, elles aussi, droit à des espaces où elles peuvent s’épanouir, sans être exclu·es, infantilisé·es, fétichisé·es, ou oubli·é·es.
La fête, en tant qu’espace social et culturel à part entière, agit comme un véritable microlaboratoire du réel, c’est un « un haut lieu du politique, au sens de la dynamique de pouvoir qui se trouve au cœur des sociétés », selon l’anthropologue Emmanuelle Lallemant. Elle est également une « expression du politique » puisqu’elle peut être « vectrice de revendications et d’affirmations de droit des minorités ».
Ces dernières années, les luttes contre les violences sexistes et sexuelles, contre le racisme et pour plus d’inclusivité dans les milieux festifs ont gagné en visibilité. Des collectifs ont émergé, des initiatives sont nées. Et c’est important : les fêtes, notamment techno et électro, sont à l’origine nées de la nécessité de créer des espaces pour les personnes exclues, Noir·es, Latinx, queers des espaces de liberté et d’expression.
Alors, pourquoi ne pas inclure aussi la lutte contre le validisme dans cette dynamique ?
Pourquoi si peu de débats autour de l’accessibilité, de la représentation et de la place des personnes en situation de handicap dans nos fêtes ?
Petit disclaimer : bien que dans les milieux festifs le mot « inclusif » est très largement utilisé pour décrire une « teuf inclusive », il est plus adapté de parler d’accessibilité pour parler des luttes handies, et contre le validisme.
Le validisme, un système qui traverse notre société
Le handicap est défini par la loi du 11 février 2005 comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le collectif intersectionnel et handi-féministe Les Dévalideuses décrit le handicap comme « un ensemble » qui prend différentes formes, « au croisement d’une expérience individuelle interne et d’un environnement inadapté ».
Le handicap est donc avant tout une situation vécue individuellement dans une société qui, elle, n’est pas adaptée à ce vécu et aux besoins spécifiques des personnes. Le collectif rappelle souvent que si, historiquement, les luttes pour les droits des personnes handicapées se concentrent sur l’aspect médical, elles portent aujourd’hui davantage sur les phénomènes sociaux d’exclusion ou d’empêchement : le validisme.
Le validisme désigne un système de domination qui discrimine les personnes handicapées, perçues comme ne correspondant pas aux normes médicales et sociales de la « validité ».
Ces personnes sont alors considérées (explicitement ou implicitement) comme moins « valables », donc potentiellement discriminables. Un système qui traverse toutes les sphères de la société, y compris le secteur culturel et festif.
S’intéresser aux luttes handies dans le prisme de la fête est primordial. Les espaces festifs et culturels sont des lieux de possibles vulnérabilités, et de possibles violences pour les femmes, les minorités de genre, les personnes racisé·es, précaires, les personnes LGBTQIA+, grosses, etc.
Comme le rappelle le collectif handi–féministe des Dévalideuses : « Les femmes et minorités de genre handicapées font l’objet, au plus haut degré, des formes de domination […], qu’elles soient privées, institutionnelles, médicales, ou économiques. » Ainsi, il est fondamental de comprendre que les oppressions se cumulent et se croisent, mettant donc en lumière l’importance de porter une attention globale à l’ensemble des luttes : une vision intersectionnelle.
La culture et la fête : un accès encore trop inégal
Selon plusieurs études du Défenseur des droits, les personnes en situation de handicap ont un accès plus limité à la culture, que ce soit comme public ou dans la création elle-même. Participer à des festivals ou à des soirées relève souvent du parcours d’obstacles : terrains boueux, absence de rampes d’accès, signalétique inadaptée, manque d’accueil spécifique, d’espaces de retrait au calme, de casques antibruit, de places gratuites pour l’accompagnant… sans compter les prix souvent élevés de ces événements. Ces barrières excluent de fait une partie du public, notamment les personnes qui, en raison d’un handicap, ne peuvent pas toujours travailler dans un système validiste qui ignore leurs contraintes.
Alors, pourquoi penser l’accessibilité de son événement ?
Bien que la loi « pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » (11 février 2005) érige l’accessibilité en principe fondamental, la réalité reste bien éloignée.
Un premier pas consisterait à prendre en compte tous les handicaps, visibles comme invisibles, et à intégrer les personnes concernées dès la conception des événements. Autrement dit : « Rien sur nous sans nous » (ndlr : slogan politique des luttes pour les droits des personnes en situation de handicap).
Un autre axe clé serait d’anticiper les besoins, de proposer des dispositifs accessibles sans attendre que les personnes concernées aient à les réclamer. Dans le pire des cas, il est d’ailleurs préférable d’au moins informer factuellement des conditions d’accueil : chaque personne peut ensuite estimer si elle peut venir ou non.
Si la plupart des événements affichent aujourd’hui la volonté d’élargir leurs publics, de développer des politiques d’accessibilité ou de sensibiliser, la première étape reste simple : garantir un accès équitable et un environnement non discriminant. On parle souvent d’accessibilité matérielle (rampes, signalétique, toilettes adaptées, coin au calme, possibilité de s’asseoir), mais la base réside aussi dans l’accueil humain (sécurité, bénévoles, personnel du bar).
Des personnes en situation de handicap soulignent que l’accueil, au moment de leur arrivée sur le site, est déterminant : un regard bienveillant, une écoute, un accompagnement adapté peuvent transformer une expérience potentiellement compliquée en moment positif.
Penser l’accessibilité, c’est aussi nommer le validisme. Comme le rappellent Les Dévalideuses, inscrire noir sur blanc dans les chartes de bonne conduite que les comportements validistes ne sont pas tolérés, c’est déjà commencer à agir pour un espace plus sûr et qui tend à être vraiment inclusif.
Repenser la fête à sa racine ?
Penser l’accessibilité, c’est aller au-delà des réglementations et des obligations légales.
C’est repenser la fête comme un espace de sociabilité, de lien et de care : un espace où l’on peut faire communauté et exister. Ce « droit à la fête » est essentiel : il permet aux communautés de s’exprimer et de se sentir incluses. Exclure, c’est donc priver les personnes d’un lien social.
La non-accessibilité ne se résume pas seulement à des structures visibles. Se « dévalider », c’est reconnaître que les personnes en situation de handicap font la fête.
Pourtant, une idée reçue persistante voudrait qu’elles ne fassent pas la fête, ne consomment pas, ne sortent pas, ne boivent pas. Une vision profondément validiste, paternaliste et infantilisante, souvent résumée par : « On n’a pas besoin de faire ces aménagements, ces personnes ne viennent pas. »
Or, beaucoup le souhaiteraient, mais ne le font pas : par peur, par crainte de discriminations, ou par fatigue de devoir sans cesse lutter pour un désir valide – celui de la fête, du loisir.
Penser l’accessibilité, c’est rendre ce désir légitime, politique. C’est donner le choix.
Espace de lien et de soin
La fête comme lien, comme expérience et comme soin, interroge. C’est un moment où l’on s’oublie un peu, où l’on explore ses limites, ses désirs, ses excès.
Mais si la fête est aussi un espace de risques (violences sexistes et sexuelles, discriminations, consommation), elle doit être pensée comme un espace de soin partagé – surtout pour celles et ceux dont les corps sont marqués par la douleur, la fatigue ou l’exclusion.
C’est là que les enjeux d’accessibilité rencontrent ceux de la réduction des risques. Il est important de rappeler que les personnes en situation de handicap consomment davantage de produits psychoactifs que la population générale, 40% contre 34% selon la Haute autorité de santé (HAS).
Inclure ces publics dans les espaces festifs, c’est aussi rendre accessibles les dispositifs de réduction des risques : pour un accueil et une écoute non jugeants, non stigmatisants.
Les personnes en situation de handicap sont souvent doublement invisibilisées : dans la fête, et dans les politiques de santé publique.
Faire appel à des collectifs de RdR et à des collectifs de concerné·es permet d’impulser des pratiques inclusives, non jugeantes et non stigmatisantes. Être accessible, ce n’est pas seulement ajouter une rampe d’accès : c’est repenser le lieu et le soin collectif. Faire appel à des personnes concernées est primordial : « Rien sur nous sans nous. »
Par exemple, No Stage Without Us est un projet collectif de concerné·es qui milite pour l’inclusion et l’accessibilité en milieu festif et culturel. Iels proposent un accompagnement autour de « pratiques inclusives concrètes, durables et adaptées », pour déconstruire les logiques validistes dans une approche intersectionnelle.
Pour conclure ce premier article sur l’accessibilité et la fête, quelques principes essentiels pour tendre vers une accessibilité plus élargie :
Une accessibilité élargie
- Sensorielle, cognitive, économique et sociale.
- Une communication repensée (visuelle, écrite, site web accessible, langage clair : transcriptions textuelles et visuelles, multiplier les canaux de contact, audio, vidéo, texte, etc.).
- L’inclusion des personnes neuroatypiques (TSA, TDAH, etc.) dans les réflexions sur le rythme, le bruit, la lumière.
- Mettre à disposition des ressources : masque FFP2, casques antibruit, bouchons d’oreilles, etc.
Former, nommer, anticiper
- Former les équipes et le public à la notion de validisme.
- Anticiper les besoins plutôt que d’attendre des demandes individuelles, mais répondre dans la mesure du possible à des demandes individuelles si elles sont formulées.
- Nommer les comportements discriminants dans les chartes des lieux et festivals.
- Se « dévalider » dès l’accueil des publics, et dès la conception d’un événement.
Sources / Ressources :
Les Dévalideuses : site Internet du collectif
No Stage Without Us : site Internet du projet
Le Collectif des festivals :
L’accessibilité pour les personnes en situation de handicap
Dictionnaire Crip par Charlotte Puiseux : https://charlottepuiseux.weebly.com/dictionnaire-crip.html
Résolutions anti-validistes : https://lesdevalideuses.org/wp-content/uploads/2024/11/Bonnes-Resolutions.pdf
La fête, sismographe de notre société
Outils :
Les rampes d’accessibilité de la biennale internationale des arts du cirque
Zig Blanquer, La culture du valide
Addiction(s) : recherches et pratiques, Visibles / Invisibles : Les usages de drogues au croisement des regards







