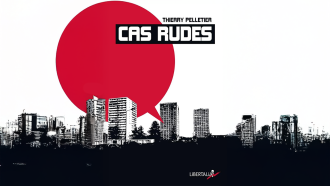En février dernier, nous avons appris le meurtre de Louise, 11 ans, à sa sortie du collège. L’assassin présumé, Owen, a justifié son acte en évoquant une défaite à un jeu vidéo.
Comme les consommations de substances, les jeux vidéo sont régulièrement invoqués comme prétexte pour minimiser, voire nier, une volonté de nuire.
Cette explication douteuse ne sert qu’à renforcer la stigmatisation déjà bien présente de cette pratique qui, comme tout outil, peut être poison mais est avant tout remède.
C’est ce que nous allons développer dans cet article.
« VOUS ÊTES DES ABRUTIS »
C’est ce que s’est permis de dire un pseudo écrivain (Yann Moix, pour ne pas le citer) lors d’une émission de télévision. Sur une chaîne grand public, il s’est permis de définir les personnes de plus de 25 ans jouant aux jeux vidéos comme des « demeurés ».
Compte tenu des aberrations qu’il affirme avec vigueur, nous pouvons considérer que la projection semble être son mécanisme de défense favori.
Outre refléter une méconnaissance infinie du sujet (et du public associé), cette remarque traduit un mépris indécent, d’ailleurs assumé par le personnage lui-même (tant qu’à faire).
Parce que mépriser certaines activités culturelles, c’est mépriser les personnes qui la pratiquent.
Parce que mépriser ces individus de cette façon, ce n’est pas une question d’opinion mais de désinformation et de rejet pour des questions éminemment sociopolitiques.
Ses propos dévoilent d’ailleurs explicitement un mépris de classe, opposant les activités culturelles valables (telles que la lecture par exemple) et celles qui ne le seraient pas (voire seraient dangereuses, sans aucun étayage scientifique à ce sujet).
Cette rivalité n’a absolument pas lieu d’être, d’autant plus quand on sait que statistiquement, les personnes qui jouent aux jeux vidéo accèdent aussi davantage à d’autres types d’habitudes multimédias – lecture, radio, tv, cinéma, etc. (Les français et le jeu vidéo, S.E.L.L, 2024).
Inutile donc de hiérarchiser des outils culturels qui permettent tous les mêmes objectifs de façons différentes : se procurer du plaisir, apprendre des choses, cultiver l’imaginaire et la créativité, etc.
Sans donner plus de crédit à ses inepties, il nous a donc semblé primordial de contrer ces dernières avec des arguments concrets et non des présupposés et jugements infondés.
Et pour ça, voyons ce qu’en disent les personnes formées et concernées !
PARFOIS JEU VIDÉO, PARFOIS JE VIS DES BAS
« Des fois jeux vidéo », c’est le podcast de Mathieu Cerbai, neuropsychologue et président de l’association Raptor Neuropsy. En plus de sa référence de génie à Marc Drouin, ce contenu a pour but de déconstruire les stéréotypes autour de cette pratique et de comprendre ses multiples bénéfices. Un bon moyen de se forger des croyances plus adéquates et justes quant à cette activité.
Here we go !
Tout d’abord, les jeux vidéo représentent un champ extrêmement vaste.
Une définition unique ne serait donc pas représentative de tout ce qui existe, mais nous pouvons les qualifier comme étant des logiciels de divertissement qui nous permettent d’avoir des interactions et de contrôler un environnement virtuel.
Le lien entre les jeux et l’adolescence figure parmi les multiples clichés concernant ce domaine.
Or, outre le fait que ne pas considérer le jeu en dehors de cette phase du développement est tout de même très triste, il s’avère que c’est tout à fait faux pour les jeux vidéo puisque 69% des adultes sont concernés (une majorité, donc) !
Une autre idée reçue qui a la peau dure est celle du lien de cause à effet entre ces types de jeux et des comportements violents/agressifs.
Tout d’abord, aucune corrélation n’a jamais été établie entre agressivité et jeux vidéo.
Et si certaines études ont pu identifier un ressenti similaire directement après le jeu, il s’agit d’un état bref, classique, qui s’inscrit sur du très court terme (comme après un film qui aurait suscité de vives émotions en nous) et surtout qui ne détermine en aucun cas un quelconque passage à l’acte.
Ensuite, si comportement agressif il y a suite à une situation rencontrée dans le jeu, la problématique se situe au niveau du rapport aux émotions et de la façon de les exprimer.
Les jeux vidéo, comme des tas d’autres contextes (réels comme imaginés), peuvent conduire à des situations frustrantes.
Si, à l’origine, la personne ne sait pas composer avec cette frustration, ça n’est en aucun cas dû à l’outil. Il peut s’agir d’une lacune d’apprentissage et c’est entre autres pour cela que les psychologues existent !
Exemple du couteau : je l’utilise pour couper mes légumes, c’est un remède ; je l’utilise pour tuer quelqu’un, c’est un poison. C’est le même outil et ce n’est pas lui le problème, c’est l’usage qu’on en fait.
Parmi les autres stéréotypes qui persistent, tels que « les hommes jouent significativement plus que les femmes » (53% versus 47%, ndlr), les jeux vidéo rendraient également bêtes et isoleraient. Tiens donc…
VIENS JOUER AVEC NOUS, DANNY
Le podcast « Des fois jeux vidéo » nous en dit plus sur les bénéfices des jeux vidéo sur notre cerveau, et plus particulièrement sur nos capacités cognitives, qui nous permettent d’interagir avec notre environnement, de percevoir, de communiquer, de s’organiser, de s’adapter.
Elles sont notamment composées des mémoires, de l’attention, des fonctions exécutives (impliquées entre autres dans la prise de décision, la résolution de problèmes), de la cognition sociale (comprendre les codes sociaux, les émotions chez les autres) et des capacités visuo-spatiales (s’orienter dans l’espace, percevoir les distances, les directions).
Malgré ses biais et ses limites, la littérature scientifique a exploré à de nombreuses reprises le lien entre le fait de jouer aux jeux vidéo et le développement de nos fonctions cognitives (Les jeux vidéo dans le soin, Yann Leroux, 2023).
De façon générale, ils amélioreraient nos capacités attentionnelles (meilleur temps de réaction, meilleure alerte, réduction des distractions), nos fonctions exécutives (amélioration de la flexibilité mentale, de la prise de décision, de la résolution de problèmes) et également la mémoire épisodique chez les personnes âgées.
Les joueurs réguliers auraient une meilleure mémoire de travail visuelle (à court terme).
Les jeux d’action (de tirs, de combat, jeux de casse-tête ou type GTA) agiraient comme des renforçateurs de nos capacités visuo-spatiales.
Les joueurs de Tetris auraient de meilleures capacités attentionnelles et visuo-spatiales.
Les exergames (jeux qui combinent activité physique et ludique) auraient des impacts positifs sur les fonctions exécutives, sur la vitesse de traitement de l’information et la rapidité chez les personnes âgées.
En ce qui concerne la cognition sociale, les jeux vidéo peuvent tout à fait servir de support (renforcer les compétences en incarnant différents personnages, se mettre à la place de l’autre), notamment chez les personnes concernées par les troubles du spectre autistique puisque ce sont des difficultés qu’elles peuvent rencontrer.
Principalement dans les RPG (Role Playing Game), le personnage joue un rôle de médiateur entre le joueur et ses difficultés liées aux émotions, lui permettant ainsi d’avoir le contrôle et de mettre du sens en les mettant en scène.
Ainsi, les jeux vidéo peuvent même booster les compétences émotionnelles et permettre le développement de stratégies de régulation émotionnelle (Villani et al., 2018).
L’intérêt est ensuite de pouvoir transférer ces compétences cognitives dans les activités du quotidien (notamment à travers un accompagnement thérapeutique ou éducatif), en faisant émerger les stratégies que les joueurs utilisent dans leur partie (identifier ces techniques apprises et comment les adapter en situations réelles).
Vous l’aurez donc compris, même si l’hypothèse d’une possible désensibilisation à la violence (et d’une possibilité de la réitérer dans le monde réel) existe, elle n’est pas établie.
De plus, elle ne pourrait être envisagée qu’en prenant en considération de nombreux autres facteurs (tels que le profil de l’individu, l’environnement, les souffrances diverses, etc.).
Pour reprendre l’image du remède et du poison, nous avons pu démontrer qu’il existe également (et principalement d’ailleurs) l’hypothèse de la catharsis.
Autrement dit, les jeux vidéo sont des outils permettant principalement l’envoi du stress et de la tension dans un monde qui n’existe pas.