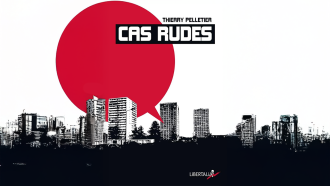
Une bande dessinée peut-elle être un outil de savoir et de compréhension ? Les adeptes du bédéjournalisme vous diront que oui, nous aussi du coup ! Retour sur un objet de divertissement intelligent !
Mathieu est dessinateur de bd (une autre corde à son arc), après une première mission illustration avec Médecins du monde, il entreprend de réaliser un reportage au sein de la halte soins addictions parisienne gérée par l’association Gaïa. Salle de consommation à moindres risques ou salle de shoot selon qui en parle, c’est là que l’auteur passe plus d’un an en immersion afin de voir, comprendre ce qui se joue dans ces murs et permettre au grand public d’en faire de même.
À travers une succession de courts chapitres, on découvre en même temps que le narrateur les coulisses de l’endroit mais aussi ses différentes missions, le public qui le fréquente, les professionnel·les qui l’animent et même, le réseau dans lequel il s’inscrit. D’ailleurs, vous pouvez consulter les premières pages de la bédé sur le site de l’éditeur.
On y voit des choses difficiles. On y voit, au sein de la capitale, des zones de non-droit où des gens vivent dans des conditions dignes du tiers-monde sans accès à l’eau. Sans toit sur la tête, sans accès aux soins et avec des assos volontaires mais clairement dépassées par la situation. Délaissé-es des pouvoirs publics, abandonné·es par l’État, les usagers, les riverains et les assos sont toustes dans le même bateau mais ne regardant pas forcément dans les mêmes directions. On y voit également de belles choses : la solidarité, le partage, l’aide et l’humanité. On a failli pleurer deux fois.
UNE SALLE, DES AMBIANCES…
De manière légèrement introspective, l’auteur partage aussi quelques scènes de son quotidien où semble s’immiscer son objet d’enquête. Avec des potes, dans un taxi ou devant la télévision, la question des usagers de drogues ultra précaires apparaissant sous ses yeux à mesure que ses connaissances grandissent.
Le dispositif géré par Gaïa est accolé à l’hôpital de Lariboisière dont Zarca dressait un terrible portrait, « Lariboisière, la casbah de la faucheuse », dans son Paname Underground (chapitre 10). L’hôpital y a même un accès direct pour pouvoir intervenir en cas d’urgence. Un des enjeux est évidemment de présenter l’équipe et les différentes professions qui travaillent de concert dans la salle – médiateurs, éducateurs, infirmiers, travailleurs pairs – et de démystifier ce qu’il s’y passe. Quel est l’objectif de la salle et quelles sont les missions ; même celles qui sont moins évidentes comme tourner dans le quartier, essayer d’inciter les usagers à se rendre dans la salle et parler avec les riverains. On présente aussi des usagers dans leur multiplicité.
AU CŒUR DU RÉSEAU
La longue durée d’enquête de Mat Let lui a permis de ne pas effleurer son sujet. En sortant du huis-clos de la HSA, il visualise aussi les actions d’aller-vers, de première ligne des équipes médico-sociales des Csapa/Caarud.
-
- Le Bus métha, qui stationne dans l’espace public afin de délivrer traitements de substitution, et traitements éventuels (psy mais pas que).
- L’antenne mobile, qui va dans les lieux de consommation afin de donner du matériel de consommation propre afin d’éviter notamment que les virus s’échangent et que les épidémies progressent.
- L’espace de repos géré par Gaïa et Aurore (une autre association du même type) avec douches, boissons chaudes, toilettes propres et un peu d’humanité.
- Et même le bus (un vrai bus de la RATP) cogéré avec Gaïa, Aurore et Proses – encore une autre asso du même genre) au square de Forceval (évacué depuis sans régler les problèmes des usagers). Moitié scène ouverte/bidonville où vivent les consommateurs et consommatrices. Des missions d’aller-vers, de bobologie, d’humanité dans ce lieu hors normes, dans l’angle mort de tous les services publics sauf de la police avec un manque de moyens cruel. On s’y balade avec Camille, une infirmière qui raconte l’intervention sur les lieux et dresse le portrait de certaines personnes rencontrées durant la journée.
BULLSHIT JOB
Selon vous, ramasser des seringues, est-ce que c’est un bullshit-job ?
C’est autour de cette question que tourne le court chapitre La petite ramasseuse de seringues. Malou, éducatrice spécialisée se retrouve en photo sur Twitter sur le compte d’un riverain a priori contre la HSA (les commentaires toujours indignes ça, ça ne bouge pas). Elle est très agacée, cette photo a été prise sans consentement et est accompagnée d’une légende dénigrante. On n’en parlerait pas ici si ce n’était pas l’occasion de mettre en lumière l’importance de ces missions non qualifiées. Ramasser des seringues, c’est la base surtout quand on en distribue ! C’est une mission de toutes les structures engagées et militantes dans le secteur, ramasser les seringues, aller au contact des publics les plus isolés, trouver les nouveaux lieux de consommations, savoir qu’il y a encore des usagers dans le coin, élaborer des stratégies pour les atteindre. On se posait la question il y a quelque temps des arguments de l’opposition concernant les opposant aux HSA particulièrement actif sur ce réseau social.
Les gens s’injectent, ça ne date pas d’hier. Le problème des gens à la rue, c’est d’être à la rue.
On ne peut pas demander à quelqu’un qui n’a ni toit sur la tête, ni boîte aux lettres, ni accès à l’eau ou à un lieu sécurisé de respecter l’espace public comme une personne insérée. Comment respecter la rue quand on est contraint de faire ses besoins entre deux voitures comme un animal ?
N’oublions pas qu’une grande partie des gens à la rue ont des facteurs de vulnérabilité concomitants (troubles psy, maladies chroniques, etc.) et une estime d’eux-mêmes brisée par des parcours de vie tragiques. Une scène du livre montre d’ailleurs l’auteur parler avec un usager au détour d’un Burger King. S’il tient la face pendant que le monsieur lui raconte sa vie, il n’en mène plus large dès qu’il se trouve seul. Les gens ont des parcours de vie chaotiques, n’ont pas été épargnés. La drogue parfois, souvent, sert alors de béquille. Une béquille qui fait aussi mal qu’elle ne soulage mais une béquille quand même.
LA ZONE DU DEDANS
Humain, vivant, sensible ; le livre ne s’emmerde pas à passer sous silence certains aspects moins glamours de la salle. Certains « échecs ». Des scènes de violence par exemple. Ou encore des galères de prises en charge. Des situations dans lesquelles l’auteur a une sensation d’échecs et où le personnel de la salle lui explique que c’est une galère après l’autre. Qu’on aide pas des gens – même dans une merde noire – sans leur accord. Que si on veut maximiser les chances de réussite, on ne peut pas faire sans les usager·es.
Accueil non jugeant, respect et bienveillance : des évidences pas si évidentes. Le réel en somme, le réel des galérien·nes.
À moindres risques, immersion en « salle de conso » est une bande dessinée de Mat Let mise en couleurs par Fachri Maulana publiée aux éditions La Boîte à Bulles en 2024. Objet littéraire soutenu par Médecins du monde et l’association Gaïa, il totalise 180 pages et est à mettre entre toutes les mains !






