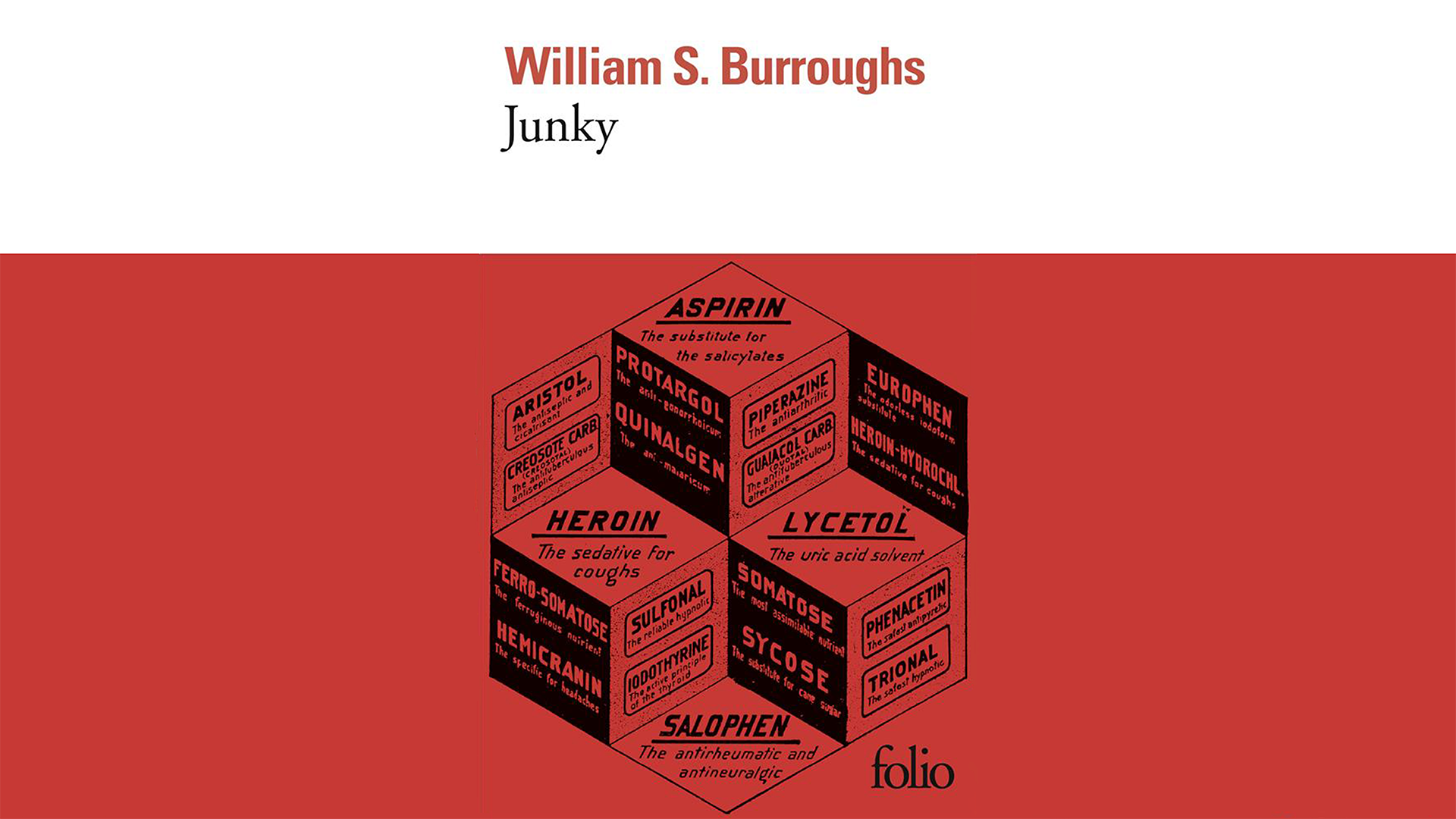L’auteur est écrivain majeur de son époque, principalement connu pour ses romans hallucinés mêlant drogue, voyage, délire et anticipation. Il est associé à la Beat Generation et à ses figures emblématiques : ses amis Jack Kerouac et Allen Ginsberg.
Il est également à noter qu’il a accidentellement tué sa femme d’un coup de feu un soir de beuverie, ce qui ne semble pas avoir posé trop de souci au monde artistique et littéraire de l’époque (mais sommes-nous encore surpris de voir de grands génies se tirer de tout type de violences, particulièrement commises sur leur entourage féminin ?).
On suit le personnage principal, un américain moyen dans les années d’après-guerre, qui plonge dans la came, à défaut de fortes motivations dans une autre direction, comme il l’explique lui-même. On est donc face au journal de l’alter ego de l’écrivain, William Lee, qui erre de petites ruses en petits trafics, de détournements d’ordonnance en détroussages de vagabonds, de bars minables en chambres pourries. On suit son quotidien dans les bas-fonds de New York, de la Nouvelle-Orléans et de Mexico, dans une fuite en avant qui le pousse à quitter les États-Unis quand la législation devient intenable pour les drogués.
Le livre est principalement constitué des errances du personnage, dont la vie, l’énergie et toutes les pensées convergent uniquement vers la drogue et la question principale : Comment se procurer la prochaine dose ? On nous y introduit une galerie de personnages marginaux, aussi originaux qu’interchangeables, tant les préoccupations demeurent toujours identiques.
Le livre est une véritable plongée dans l’univers de William, qui permet de vivre de l’intérieur un quotidien uniquement régi par la drogue et l’absolue nécessité d’assurer la prochaine prise.
Entre manque et soulagement, à l’infini.
Le récit peut paraître un peu long, il s’apparente à une succession de scènes semblables qui se répètent à l’infini, avec pour seule différence un changement de décor ou de personnages. Mais il est ici à l’image de la vie de William : une alternance sans répit entre manque et soulagement, entre abstinence et rechute, quels que soient le lieu ou les personnes qui l’entourent. Ici, tous les drogués se ressemblent et tout est décrit à travers le prisme de la « came», seul moteur de l’histoire. Il n’y a pas vraiment de péripéties à proprement parler, ni de rebondissements ou de dénouement : juste l’attente fiévreuse, la quête de produit, le manque. L’écriture est factuelle, clinique, presque désincarnée.
L’écrivain nous fait vraiment comprendre que selon lui la drogue est un mode de vie qui occupe tout, prend tout et ne laisse rien d’autre à celui ou celle qui l’adopte.
Est-ce qu’il y a des choses à tirer en termes de réduction des risques ? Pas du tout ! Il est intéressant de constater à quel point la répression policière est inutile et la criminalisation de l’usage inefficace. Un revendeur en remplace un autre immédiatement, toutes les combines sont bonnes pour continuer, même les plus risquées. À l’époque, avoir des marques de piqûres sur le bras peut vous envoyer en prison pendant des années. La plupart des personnages finissent donc morts ou derrière les barreaux, sans que cela ne résolve quoi que ce soit au problème de santé publique en question. Les cures proposées semblent également être très peu adaptées et peu d’options s’offrent aux personnages qui souhaitent décrocher.
Junky est le premier roman du célèbre écrivain américain William S. Burroughs, paru en 1953.