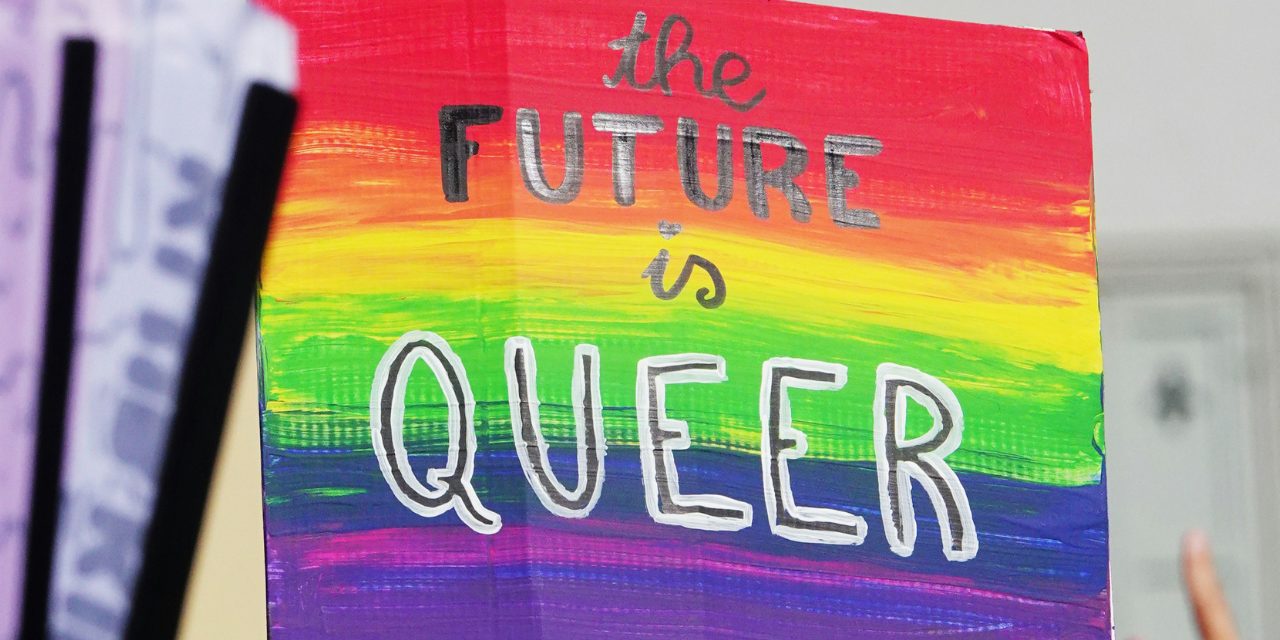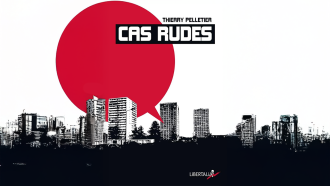Le mois de juin, historique « mois des fiertés », s’achève. Un mois de mise à l’honneur pour les personnes LGBTQIA+ durant lequel un grand nombre de pays ont vu défiler dans leurs rues des cortèges de manifestant.es, bravant parfois des interdictions, appelant à défendre leurs droits en se dressant contre l’obscurantisme et les discours de haine, à visibiliser leur existence et à imposer dans le débat public leurs revendications. Plus que jamais, face à l’internationale réactionnaire, ces luttes s’avèrent vitales et résister est un devoir.
La Marche des fiertés, autrefois plus connue sous le nom de « Gay Pride », tire ses origines des émeutes de Stonewall. Tout commence dans un bar de quartier de Greenwich Village à New York, connu pour être fréquenté par des personnes homosexuelles et transgenres, racisées pour beaucoup. À l’époque, les lois LGBTphobes font rage et les descentes de police sont monnaie courante. Mais dans la nuit du 27 au 28 juin 1969, tout bascule. Révolté.es, les client.es du bar refusent de se laisser faire et répondent aux forces de l’ordre : des émeutes éclatent pendant plusieurs jours.
Ces événements marquent un tournant dans les luttes LGBT, et tout juste un an plus tard, des marches commémoratives voient le jour à New York, Los Angeles et Chicago.
LES LUTTES LGBT, UN ENJEU INTERNATIONAL FACE A LA MONTÉE DE LA HAINE
Cinquante ans plus tard et partout dans le monde, les discours LGBTphobes tiennent le haut du pavé. De Donald Trump à Vladimir Poutine en passant par Viktor Orban, l’internationale réactionnaire s’unit et place au centre de ses discours discriminants les personnes LGBTQIA+, désignées comme des ennemi.es dans leur idée de réinstaurer un ordre moral d’un autre temps avec une vision conservatrice des rôles genrés, de l’amour, de la sexualité et de la famille.
En Europe, les discours suivent cette dynamique et fleurissent de toute part comme des axes politiques majeurs de restriction des libertés, les thématiques de l’extrême droite ayant gangréné la sphère médiatique et politique. La bataille idéologique conservatrice est en marche, et si elle fait déjà mal dans les urnes, elle est aussi omniprésente dans la parole. Ses représentant.es font front commun et les discours ne suffisent plus, ils s’appuient désormais sur des actes.
Depuis son élection aux États-Unis, Donald Trump multiplie les attaques contre la communauté LGBT et contre les femmes, utilisant la transphobie comme stratégie politique et multipliant les décrets portant atteinte aux droits des personnes transgenres, interrompant le financement de la lutte contre le VIH, et faisant également de la lutte anti-avortement son cheval de bataille. La liste est non exhaustive et terrifiante. De son côté, après avoir interdit les transitions de genre et la « promotion du modèle LGBT » (d’en faire partie en quelque sorte), et avoir incarcéré des tenanciers de bars communautaires, Vladimir Poutine désigne à présent le mouvement international LGBT comme un terrorisme extrémiste. Osé. Son influence s’est fait ressentir à grands coups de lois homophobes et transphobes en Géorgie ou encore en Hongrie, où Viktor Orban, oligarque d’extrême droite et allié historique Européen de Marine Le Pen, a carrément fait interdire la Pride 2025 après avoir multiplié les restrictions. Mauvaise manœuvre, puisque des militant.es du monde entier sont venu.es soutenir leurs adelphes opprimés, et ce sont plus de 200 000 personnes qui ont défilé dans les rues de Budapest pour défendre leur liberté d’exister.
De manière générale, les discours archaïques se multiplient en Europe, de l’Italie populiste de Meloni à la France et ses votes RN en explosion. Face à ces discours accablants et à la menace qui pèse sur les personnes LGBTQIA+, les Marches des fiertés se sont cette année démarquées par des participations records et des messages ultra politisés contre l’offensive réactionnaire.
LA LUTTE LGBTQIA+, UN ENJEU DE LA RDR
La réduction des risques trouve racine au sein des luttes LGBTQIA+.
Elle naît pendant l’épidémie sida pendant laquelle la communauté homosexuelle, frappée de plein fouet, met en place la solidarité et se bat, au chevet des malades mais aussi dans la rue pour réclamer des réponses financières et médicales aux responsables politiques indifférents. Parce qu’il s’agit de populations discriminées, la survie des malades n’apparaissait pas comme une priorité gouvernementale. L’échange de pratiques, le soutien communautaire, et la lutte pour l’accès aux soins pour toustes ont permis d’apporter des solutions à la crise sanitaire et de développer une autre idée de la prise en charge médicale : plus bienveillante, plus empathique, et donc aussi plus efficace.
Dans des sociétés reposant sur un modèle hétérosexuel dominant, difficile en outre pour les personnes LGBT de créer des liens, de faire des rencontres et de prétendre à une vie amicale et sentimentale, tout en vivant librement leur sexualité. C’est ainsi que les fêtes queers émergent, avec l’apparition de la techno et de zones « safe », loin des codes normés qui régissent les soirées. Véritables lieux de sociabilisation pour sortir de l’isolement dans lequel une orientation sexuelle ou une identité de genre peut cloîtrer, les fêtes se font facteurs d’épanouissement, mais exposent aussi les personnes aux consommations. Dans ces cadres festifs, les échanges de pratiques continuent, et la réduction des risques s’implante encore dans des logiques de pair-aidance.
La réduction des risques, c’est aussi intervenir sur des questions de vie sexuelle et affective. La stigmatisation enferme les LGBTQIA+ dans des pratiques sexuelles à risques par désinformation, par honte d’être jugé.e ou maltraité.e dans le cadre médical. Placées en dehors d’enjeux reproductifs et moins concernées par les questions contraceptives, les lesbiennes ou les personnes transgenres sont souvent exclues de la gynécologie, obtenant des diagnostics tardifs et de moins bons suivis.
LA LUTTE LGBTQIA+, UN ENJEU RURAL
Longtemps considérées comme l’affaire des grandes villes, de par leurs lieux LGBT plus nombreux et leurs réseaux plus étendus, les Prides sont pourtant aussi l’affaire des zones rurales. En effet, il y a toujours eu des personnes LGBT dans les campagnes, et cette année particulièrement, les manifestations ont trouvé un essor notable, avec plusieurs dizaines de points de rendez- vous répartis dans toute la France. Mobilisation d’urgence de masse contre l’internationale réactionnaire ? Bien sûr, mais aussi auto-organisation revendicative car malgré les préjugés citadins, la volonté de regroupement et de faire communauté existe également et compose avec les réalités locales. Il s’agit également d’échapper à une vision binaire qui occulte l’hétérogénéité de ces espaces et d’en briser les clichés empreints de classisme selon lesquels seules les villes seraient « queer friendly », alors que c’est statistiquement davantage en zone citadine que les agressions homophobes ont lieu.
Dans des zones touchées par la montée de l’extrême droite, les enjeux de conviction sont encore plus forts et l’utilité de « faire territoire » criante, en luttant aussi bien pour les droits LGBTQIA+ que pour le maintien des services publics, d’accès à l’emploi ou aux soins. Ces marches se font un véritable acte de résistance et de visibilité.