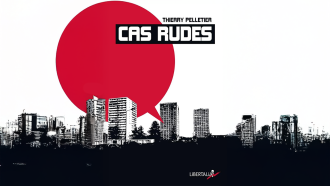Bien évidemment, le titre de cet article ne s’adresse pas au documentaire – ô combien intéressant – toujours disponible sur arte.tv, qui aborde successivement la construction historique, sociale et culturelle de la masculinité à travers différentes époques ; mais plutôt à l’idée que nombre d’entre nous se font encore du concept de « virilité ».
Hop là, on vous voit venir avec vos sempiternelles phrases de dédouanement tristement cultes : « Hé, tu ne vas pas m’apprendre ce que c’est que le féminisme, j’ai grandi avec des femmes. » Ce qui tombe plutôt bien puisque – spoiler – cela n’a jamais été le sujet.
Il n’est pas question ici de s’opposer mais de questionner et de réfléchir aux violences et aux inégalités sociales que nous véhiculons et subissons toustes à travers ce concept archaïque et abscons de « virilité », relaté de manière pédagogique dans le documentaire susmentionné.
Une structuration sociale, pas une fatalité biologique
La domination masculine, comme l’aborde également le sociologue Pierre Bourdieu, trouve son origine dans une structuration de la société promue par un certain nombre d’« agents » – sans grande surprise : Institutions, Familles, Église, École, État – qui forment l’archéologie d’un inconscient commun ultra-violent.
La domination masculine n’est pas naturelle. Elle n’est pas innée mais construite historiquement, perpétuée et véhiculée à travers les actes du quotidien ou encore par l’art – salut à Rambo et autres personnages célèbres bardés de muscles transpirants, témoignant de peu d’émotions et aux phrases contenant rarement plus qu’un verbe, un sujet et un complément d’objet direct.
Partant de là, les effets de cette violence symbolique sont particulièrement intéressants à analyser car elle s’exerce sans malveillance : bien souvent, elle n’est même pas conscientisée par ses principaux acteurs, qui l’exécutent avec innocence et habitude, puisqu’elle est liée à un système, un ordre social, une vision sexuée rendant ces comportements automatiques.
Et c’est précisément ce caractère automatique qui rend la chose effrayante et véritablement dangereuse.
Le rapport des genres n’étant pas équilibré – il ne peut exister de dominant sans dominé·e –, les femmes et minorités de genre sont condamnées à ne se (perce)voir qu’à travers le prisme des catégories dites « dominantes ». Cette soumission est paradoxale, car inoculée dès la naissance, et donc invisible aux yeux de ses victimes, qui en viennent à entretenir elles-mêmes ce rapport de domination.
Jusqu’au jour fatidique où quelque chose s’éveille, où l’on dit « Non ».
Les masculinités – Tiens, y aurait-il des dissensions dans les rangs ?
Lorsqu’on aborde la notion de la masculinité, il est pertinent de se pencher sur les travaux de Raewyn Connell, sociologue australienne, qui critique l’idée d’une masculinité unique. Selon elle, la masculinité n’existe en effet que dans des cultures qui opposent masculinité et féminité. La masculinité peut être comprise comme un ensemble de pratiques, de personnalités et de cultures partagées par toustes.
Connell conceptualise ainsi quatre types de masculinités :
- Hégémonique : la masculinité dominante, incarnée par l’homme blanc hétérosexuel, de catégorie socioprofessionnelle supérieure, « viril » – le héros de cinéma, sans émotion ni remise en question, convaincu d’être l’Alpha dont l’humanité aurait besoin pour survivre.
- Complice : ceux qui profitent de l’ordre établi sans forcément y adhérer pleinement – et sans interroger leurs privilèges – en tirant malgré tout bénéfice du patriarcat.
- Subordonnée : ceux dont la masculinité est remise en question, posée en contre-modèle – par exemple, les masculinités homosexuelles.
- Marginalisée : ceux des minorités ethniques ou sociales qui peuvent performer certains traits dits « virils » sans pour autant bénéficier du pouvoir associé.
Finalement, même les autoproclamés « vrais hommes » sont traversés par des contradictions internes. Qui est un homme ? Qui l’est à moitié ? Qui ne l’est pas ? Qui n’a même pas l’autorisation de se revendiquer du genre masculin ?
Et si la masculinité hégémonique ne faisait plus bander personne ?
Ces dissensions sont de plus en plus visibles ces dernières années, avec différentes « tendances » qui émergent sur les réseaux sociaux, révélant les fissures d’un modèle en bout de course. Parmi elles, celle des « hommes princesses », qui s’approprient des codes traditionnellement dits « féminins » — recevoir des fleurs, se faire inviter au restaurant — pour questionner les normes de genre.
Un geste intéressant, même si résolument réducteur : car l’égalité entre les genres ne se limite pas à inverser les rôles ou à reproduire les mêmes schémas dans l’autre sens — vous l’avez ce fameux banger maintes fois entendu ? « Puisque vous avez voulu l’égalité, payez l’addition », au sens stricto sensu du terme.
Une réaction qu’on pourrait qualifier d’Alpha-llique – pour injecter un peu de poésie – ou simplement d’extrêmement primaire, vidée de tout contenu politique, symptomatique d’une incapacité à penser le changement autrement qu’en mode binaire.
Cette fameuse « crise » – loin d’être alarmiste – prend un tout autre éclairage lorsqu’on rappelle que, dans son étymologie grecque, krisis signifie « changement, décision ».
Serait-il temps pour les masculinités de s’extraire des constructions inculquées dès l’enfance pour être plus en phase avec ceux qui deviendront un jour un·e adulte conscient·e ?
La crise d’adolescence, perçue majoritairement de façon péjorative, est un moment de rupture, de questionnement, d’émancipation des modèles initiaux. Elle n’est pas une fin, mais bien un développement : quitter l’identité imposée pour s’ouvrir à la pluralité, à l’altérité – en l’occurrence, aux multiples identités de genre ?
Et si la « crise » de la masculinité n’était pas une disparition, mais un passage vers une humanité dégenrée, plus collective, moins hiérarchisée ?
Le prochain chapitre pourrait bien être celui où l’on cesse d’être « des hommes » pour devenir des humain·e·s parmi d’autres humain·e·s.
Loin d’être une catastrophe, la « crise » est une chance pour évoluer vers une coexistence non-hiérarchisée des genres.
Après tout, que perdrait-on à être, simplement, des êtres humains en relation ?
Ici à KEPS, on tente de proposer un cadre safe et bienveillant et on décide d’interpréter ces comportements et idéologies comme le fait d’affirmer qu’il n’existe pas de masculinité universelle. Seulement des relations de pouvoir variables, des humain·e·s en questionnement pour certain·e·s, en réaction face au changement pour d’autres, ou encore en rejet total d’une mutation sociale – mais pas de panique, celle-ci est en cours, et se fera, avec ou sans eux.
📞 Envie de réponses ou simplement d’être écouté·e ? 3615 KEPS, ce sont les rendez-vous qu’on te propose le mercredi et jeudi de 14h à 17h. Envoie-nous un message, on est là pour toi.