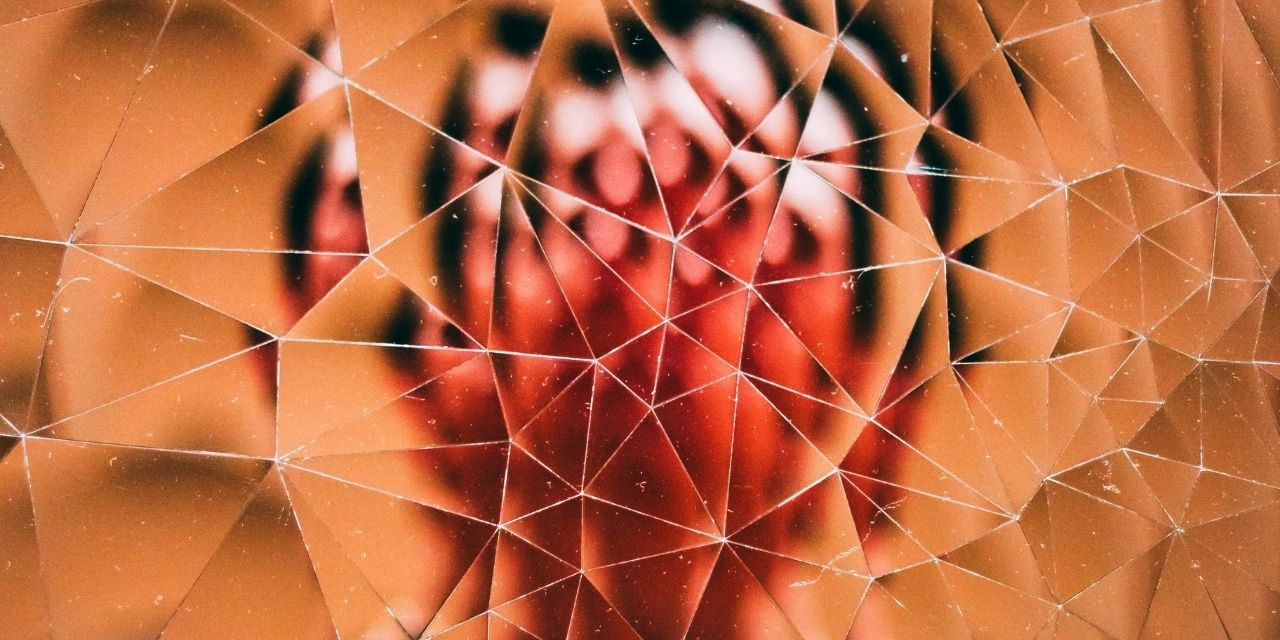X, 23 ans, est en master mais ses études sont en suspens, rythmées par des nuits sans sommeil. On lui a prescrit un anxiolytique pour calmer ses crises de panique, un antidépresseur est envisagé, mais les rendez-vous spécialisés tardent. Parfois, quand l’insomnie le ronge, il fume un joint. Quand la panique revient, un verre d’alcool ; quand l’énergie manque, il essaie de petits stimulants empruntés. Il n’est ni « usager à problèmes » ni « patient parfait » : il est un point vivant sur cette ligne de crête entre soin, bricolage et survie.
Ce portrait n’est pas isolé. Pour beaucoup de jeunes adultes, la santé mentale se joue entre ordonnances, stratégies personnelles et zones grises. Médicalisation massive, diagnostics qui tardent, bricolages individuels : ces réalités se croisent et racontent une génération qui compose avec des ressources fragiles, des attentes, et des risques bien réels.
Une médicalisation massive… mais fragile
La France figure parmi les pays où les psychotropes sont les plus prescrits. Selon Santé publique France, seize millions de personnes âgées de 11 à 75 ans déclarent avoir déjà pris un médicament psychotrope. Les anxiolytiques arrivent en tête, suivis des hypnotiques et des antidépresseurs. Dans le détail, 10% de la population a consommé un anxiolytique au cours de l’année écoulée, 6% un hypnotique, et autant un antidépresseur.
Depuis la pandémie, les données confirment une augmentation persistante de ces prescriptions, notamment chez les jeunes adultes. Les différents récits reçus témoignent d’une chose : une tendance à la médicalisation « rapide », sans « donner la moindre information » sur le produits ou alors un traitement qui peut « effrayer » qu’on donne systématiquement sans poser un diagnostic – « il ne faut pas s’enfermer dans une case », tout en encourageant la prise d’antidépresseurs.
Si cette médicalisation massive répond à une demande réelle, elle révèle aussi ses limites. Dans certains cas, les prescriptions sont rapides, sans évaluation globale, et peuvent générer une dépendance iatrogène.
Ailleurs, des jeunes en souffrance restent sans suivi adapté, faute de professionnels disponibles ou de diagnostic posé.
L’efficacité des traitements est par ailleurs inégale : certains trouvent un soulagement, d’autres subissent des effets secondaires ou n’observent que peu d’amélioration. Les médicaments peuvent stabiliser, mais rarement transformer durablement une trajectoire quand ils ne s’inscrivent pas dans un accompagnement global.
L’errance diagnostique : la face cachée
Derrière les ordonnances, il y a aussi le vide. Beaucoup de jeunes adultes naviguent des années dans l’incertitude avant d’obtenir un diagnostic clair. Le retard ou l’absence de diagnostic n’est pas anodin : il pèse sur les parcours scolaires, professionnels et relationnels.
Dans les différents témoignages recueillis, Alexis et Maëlle* racontent la difficulté du diagnostic, des soignants pas toujours formés pour recueillir la parole, la société qui n’est pas au fait.
Alexis : « Aussi, ces années d’errances auraient pu être bien plus courtes si le monde était moins psychophobe et mieux renseigné sur les troubles psy. »
Maëlle raconte aussi que dans monde psychophobe, cette lenteur, cette non–connaissance et la difficulté de mettre des mots sur sa souffrance n’est pas sans conséquences.
« Il y a aussi une forme de légitimité que j’ai du mal à gagner. Ça m’a heurtée de plein fouet avec, notamment, des personnes qui n’avaient jamais eu de problèmes psy. Ces personnes – et ce n’est pas leur en vouloir – n’appréhenderont jamais la douleur, la culpabilité, le besoin de disparaître, la paralysie, l’impossibilité d’agir. »
Qu’il s’agisse d’anxiété persistante, de dépression, de troubles bipolaires ou de traumas complexes, les réponses médicales arrivent souvent tard. Dans le cas du TDAH (trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité), par exemple, une étude française a montré que près de la moitié des adultes diagnostiqués considéraient leur parcours comme « difficile à très difficile ».
Faute d’un diagnostic plus précoce, les adultes diagnostiqués TDAH par la suite mettent des mots, enfin, comprennent un système mental différent et que le problème, ce n’est pas eux. Bavardages, mauvaises notes, énergie débordante, enfin cela a du sens : « Sur le TDAH, grâce aux informations que j’avais récoltées sur ce trouble, j’ai entamé un coming in qui m’a fait me rendre compte que j’étais ni “une sauvageonne” ni “un boucan”, et que ma mémoire allait très bien (mis à part les dégâts de la dépression et de la drogue sur cette dernière). Mais que j’étais probablement neuro–atypique. »
Mais le problème ne se limite pas à ce trouble précis : il s’agit d’un symptôme structurel d’un système de soins saturé, où les délais de rendez-vous, le manque de formation et les biais de genre ou de classe retardent la reconnaissance.
Les conséquences sont multiples. Faute d’explication claire, beaucoup se tournent vers l’automédication. La confiance envers les professionnels s’érode après des consultations infructueuses. Ne pas avoir de nom pour qualifier sa souffrance fragilise le sentiment de légitimité et alimente la culpabilité. À long terme, l’absence de diagnostic adapté abîme les trajectoires, avec des études interrompues, des emplois précaires et des relations sociales fragilisées.
L’automédication, elle, se fait aussi collectivement, les personnes concerné·e·s s’auto–éduquent pour pallier à un système de soins qui peut faire mal. Alexis a déjà dépanné des copains en Ritaline® : « Il m’est arrivé de dépanner de la Ritaline® à des connaissances qui s’automédiquaient car je crois en la clairvoyance des individus sur leur psyché. »
Les bricolages du quotidien
Face aux limites du système, nombre de jeunes inventent leurs propres solutions. Le terme de « bricolage » traduit bien la réalité : faire avec ce qui est disponible, souvent dans l’urgence.
Le cannabis est utilisé pour calmer l’anxiété, favoriser le sommeil ou « couper le bruit mental », comme le fait Maëlle. « Mais moi, je voulais – et je veux toujours – aller mieux. Arrêter de me sentir comme une déception constante. C’est tout ce que je demande. (…) Alors oui, j’ai souvent préféré fumer jusqu’à anesthésier mon cerveau que de prendre sans cesse des benzos. »
L’alcool, socialement toléré, devient parfois une béquille ponctuelle lors des crises. Les stimulants comme la cocaïne, les amphétamines ou la caféine à forte dose servent à tenir le rythme des études ou du travail. Alexis, dans le témoignage qu’iel a livré à KEPS raconte aussi les ruptures de stocks (très fréquentes ces dernières années), qui mènent à des solutions DIY (Do it yourself).
Avec le temps, les médicaments font moins d’effets, alors Alexis se retrouve à prendre de la cocaïne seul·e pour se calmer, pour tenir le rythme pour gérer son TDAH, et cela pendant plusieurs semaines.
Les médicaments, lorsqu’ils sont obtenus sans ordonnance ou utilisés hors du cadre prescrit, complètent parfois ces stratégies.
Des pratiques rarement isolées. Beaucoup combinent plusieurs substances, par exemple un antidépresseur prescrit avec du cannabis, ou un anxiolytique accompagné d’alcool. Ces polyconsommations restent invisibles dans les consultations médicales, parce qu’elles échappent aux cadres établis.
Ces mécanismes remplissent plusieurs fonctions. Ils permettent de réguler les émotions dans l’urgence, de combler les trous du système de soins, de masquer une souffrance dans un environnement exigeant, ou encore de s’approprier une forme d’autonomie : « Je me soigne comme je peux ». Ils ne sont pas toujours pathologiques, mais ils révèlent les manques structurels du système et l’inventivité des individus pour survivre.
Quand les trajectoires s’abîment
Ces zones grises ont un coût humain. Dans les parcours universitaires, elles se traduisent par des décrochages, des échecs ou des abandons. Sur le plan professionnel, elles entraînent fatigue, instabilité et précarité. Dans la vie sociale et affective, elles nourrissent l’isolement, l’incompréhension et la stigmatisation.
Le stigmate enferme : être perçu comme « consommateur de stup’ » plutôt que comme « personne en souffrance » ajoute une double peine. Beaucoup taisent ces trajectoires hybrides, où le soin et l’usage se mêlent. Pourtant, des ressources existent. Les communautés de pairs, les forums en ligne et les associations offrent des espaces d’échange et de reconnaissance. Ils ne remplacent pas la médecine, mais ils permettent de briser le silence et de partager des stratégies d’adaptation et de survie.
Toutes les personnes qui témoignent se rejoignent : bricoler, c’est aussi avancer et faire le chemin soi-même face à des murs, ou à la stigmatisation de la société et sa psycophobie : « Si je n’arrivais pas à vivre, c’était parce que je faisais juste pas assez d’efforts. Spoiler alert, pendant mes six années d’errance, j’ai fait que ça, faire des efforts. »
Pour une réduction des risques en santé mentale
La santé mentale des jeunes adultes ne se distribue pas en cases séparées. Elle traverse les prescriptions médicales, les diagnostics retardés, les bricolages individuels et les trajectoires abîmées. Reconnaître cette continuité est essentiel.
Une approche de réduction des risques appliquée à la santé mentale ouvre des pistes concrètes. Il s’agit de reconnaître les bricolages au lieu de les condamner, de réduire les délais d’accès au diagnostic, de former les professionnels à accueillir les usages « hors cadre », et de développer des espaces mixtes où soins et pair-aidance se rencontrent.
La santé mentale est un enjeu collectif. Les psychotropes, prescrits ou bricolés, en sont une composante incontournable. En clôture de ce mois, il s’agit d’une invitation à penser autrement, à écouter ce qui reste invisible, et à construire des ponts plutôt que des murs.
* Les prénoms ont été modifiés
Sources
- Santé publique France, Les consommations de médicaments psychotropes en France (2021) : notice, rapport PDF.
- Respadd
- Étude ECRIN (Université de Strasbourg), Vécu du parcours diagnostique à l’âge adulte (2022) : notice.
- Fondation FondaMental, Bipolarité : retard au diagnostic : fondation-fondamental.org
- ScienceDirect, Impact de la pandémie sur la consommation de psychotropes en France (2024) : article.