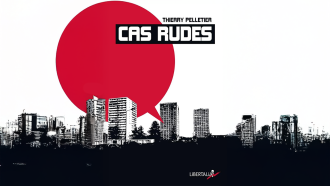Et si nos addictions disaient quelque chose du monde dans lequel nous vivons ?
TW : mention de violences et actes de terrorisme
3 Choses à retenir :
🧠 1. Une décennie de chaos a profondément marqué les esprits
Entre 2015 et 2025, la France a traversé une série d’événements collectifs violents — attentats, pandémie, répression, guerres, crises sociales, réchauffement climatique… Autant de traumatismes partagés qui ont nourri un climat d’anxiété, d’insécurité et de perte de sens.
💥 2. Les usages de drogues s’inscrivent dans cette réalité traumatique
Les données de l’OFDT montrent une hausse générale de l’expérimentation et des usages, notamment du cannabis. Ces comportements ne sont pas à lire seulement sous l’angle moral ou légal, mais aussi comme des réponses individuelles à des stress collectifs.
💬 3. Le lien entre trauma et addiction doit être mieux compris et accompagné
Les jeunes, les femmes et les personnes LGBTQIA+ sont particulièrement vulnérables aux effets combinés du traumatisme et de l’addiction. Mieux comprendre ce lien, c’est ouvrir la voie à des accompagnements plus humains, plus adaptés et moins stigmatisants — qu’ils soient thérapeutiques ou communautaires.
Une consommation en progression continue
Depuis vingt ans, la consommation de drogues est en hausse. Qu’est-ce qui pourrait expliquer ce curieux phénomène ?
Si l’on se réfère aux rapports « Drogues et addictions), chiffres clés » de l’Observatoire français des drogues et tendances addictives (OFDT), toutes les drogues surveillées ont vu leur nombre d’expérimentateurs et d’usages dans l’année augmenter depuis 2007 :
- Alcool + 4,5 millions d’expérimentateurs ;
- Tabac + 2,2 millions ;
- Cannabis + 8,6 millions ;
- Cocaïne + 2,6 millions ;
- MDMA + 2,3 millions ;
- Héroïne + 490 000.
En ce qui concerne l’usage quotidien, le cannabis est également en hausse significative (+ 3,5 millions d’usager·es quotidiens).
Comment expliquer cette tendance à la hausse des consommations de drogues ? Et si c’était le marqueur d’une société qui s’enfonce dans l’angoisse ?
Quand l’histoire récente nourrit l’angoisse collective
2015-2025 : Tout est chaos
« Ce n’est qu’avec le passé qu’on construit l’avenir » disait Anatole France. Validons sa thèse et plongeons-nous dans la décennie de chaos que nous venons de traverser en dressant une liste non-exhaustive d’événements traumatisants pour la nation et ses habitant·es :
- 2015 : Attentats contre Charlie Hebdo, prise d’otages de l’Hyper Cacher, attentat déjoué dans le train Thalys, multiples attentats du 13 novembre.
- 2016 : Attentat du 14 juillet à Nice.
- 2019 : Répression drastique du mouvement des Gilets jaunes.
- 2020 : Assassinat du professeur Samuel Paty et confinements successifs liés à la pandémie de Covid-19.
- 2022 : Invasion et début de la guerre en Ukraine par la Russie.
- 2023 : Émeutes nationales en réponse à la mort de Nahel à Nanterre, attaque du 7 octobre en Israël et début de la guerre et du génocide à Gaza.
« Les différents évènements violents, avec un réel potentiel traumatique pour celles et ceux qui en entendent parler, créent un stress, une anxiété, un sentiment d’insécurité ou une insécurité réelle, qui favorisent la dynamique traumatique (ils se créent plus facilement et ils s’en ravivent plus facilement). Pour le dire autrement, ce n’est pas la guerre en Europe ou le procès Pelicot qui créent des traumas chez ceux qui regardent la télé, mais ces événements du monde fragilisent, insécurisent ; et le sentiment de sécurité est une chose importante lorsqu’il s’agit de psychotrauma. Du stress dans la durée, de l’anxiété, de l’insécurité, de la peur réelle à l’usage de drogues, d’alcool et de médicaments, il n’y a déjà qu’un tout petit pas à faire ! Sans même encore parler à ce stade-là de trauma. » Comme l’explique le psychologue Laurent Weber.
Une génération marquée par le chaos
Imaginez un instant comment se sont construites les personnes nées dans les années 2000 face à tous ces événements parfois incompris sans espaces pour pouvoir en parler. Des fardeaux secrets, mais partagés sans le savoir avec les autres. Et si les enfants ne sont évidemment pas les seuls à avoir été touchés, l’enfance est un âge où l’on manque d’outils pour donner du sens aux événements. Quand on sait que réussir à donner du sens est une des manières d’éviter un psychotrauma persistant, ça fait réfléchir.
Comprendre le traumatisme
Une pathologie duelle
Interrogeons d’abord la notion de trauma grâce à la présentation du Dr Thierry Vasse dans Du traumatisme collectif à la catastrophe individuelle : « Le stress désigne la réaction immédiate bio-physio-psychologique d’alarme, de mobilisation et de défense face à une situation critique. Le trauma désigne un phénomène psychodynamique :
- d’effraction des défenses psychiques ;
- de confrontation avec le réel de la mort et du néant ;
- sans possibilité d’y répondre par l’action, la parole, la pensée ;
- sans possibilité d’y attribuer un sens. »
Selon lui, l’expérience traumatique peut être :
- un événement brutal et violent ;
- une effraction dans le psychisme de l’idée de la mort ou de sa représentation ;
- un vécu d’effroi, d’horreur, d’impuissance ;
- un arrêt de la pensée, un trou noir, une déréalisation, une désorientation.
Ces événements marquent différemment les personnes et parmi les facteurs qui modulent la réaction à un événement traumatique, on trouve la capacité de régulation émotionnelle, la qualité de l’environnement relationnel ainsi que les facteurs de vulnérabilité individuels (comme l’âge par exemple !).
Drogues et traumas : un cercle vicieux
On sait par ailleurs qu’un lien de plus en plus évident existe entre usage de drogues et psychotrauma (on en parlait ici avec Laurent Weber). Il est en effet communément admis que certaines personnes victimes de très fortes angoisses ou de dépression atténuent leurs symptômes anxieux grâce à l’usage de stupéfiants.
« Les individus souffrant d’un TSPT (trouble de stress post-traumatique) peuvent être amenés à recourir de manière répétée à des substances et/ou des comportements addictifs pour tenter de gérer, diminuer, ou contrôler leurs symptômes de TSPT, et notamment les troubles du sommeil, l’irritabilité ou l’hypervigilance. Le soulagement initial associé à l’usage d’une substance favoriserait alors la poursuite de la consommation, menant à l’installation progressive d’une dépendance. » Selon le guide pour mieux comprendre, identifier et prendre en charge le psychotraumatisme et l’addiction récemment publié par la Fédération Addiction,
Évidemment on peut aussi avoir un trouble de l’usage de substance sans avoir forcément de traumatisme sous-jacent.
Des populations particulièrement vulnérables
Le guide « Trouble de stress post-traumatique (TSPT) et trouble de l’usage de substance (TUS) : deux visages, une pathologie » de la Fédération Addiction indique en outre que :
« Les jeunes : les 18-25 ans sont les plus impactés par la pathologie duelle. Cette vulnérabilité accrue s’explique en partie par l’émergence, durant l’adolescence, de la plupart des troubles psychiatriques. Par ailleurs, l’adolescence est la période propice aux expérimentations de toutes sortes, à la recherche de nouveaux plaisirs (et de nouveaux soulagements !), le tout associé à une influençabilité sociale plus marquée.
Les femmes : une prévalence plus élevée de la pathologie duelle (par rapport aux hommes) est observée en raison de leur exposition plus fréquente et plus précoce à des évènements traumatisants.
Les personnes issues de la communauté LGBTQI+ : le risque de développer un TSPT est deux à trois fois plus élevé chez les personnes LGBTQI+. […] Ces chiffres plus élevés sont souvent liés à des agressions physiques et/ou sexuelles, ainsi qu’à des formes de stigmatisation et de micro-agressions quotidiennes. » Cette liste ne serait pas complète sans ajouter les personnes incarcérées et celles en situation de grande précarité (dont les exilées).
N’oublions pas les personnes déjà victimes de violences, plus ou moins traumatisées, qui sont bombardées de ces actualités anxiogènes !
Et si toutes ces choses, violentes ou incompréhensibles ou inconcevables avaient laissé une marque indélébile sur des individus jeunes, alors en construction ?
Survivre plutôt que vivre ?
« Ça peut très rapidement et très facilement raviver, renforcer, nourrir à en mourir, des dynamiques traumatiques. Ce qui fait le lit du trauma complexe pour moi, c’est la conjonction de vécus violents ET de l’expérience de vivre dans un monde où les auteurs de violences ne sont pas jugés, parce le monde ne veut pas entendre d’histoires très violentes. Les victimes crient, et parfois rien ne sort de leur bouche, et le monde ne veut pas entendre leurs cris (alors leurs silences… n’en parlons pas) ; beaucoup sont donc condamnés à la survivance », explique Laurent Weber.
Sortir du déterminisme
Pas une fatalité
Si en lisant cet article tu as reconnu une personne que tu connais (ou toi-même), sache que l’équation traumatisme/usage de drogues n’est pas une fatalité. Si tous les usages ne sont pas problématiques, la plupart sont interdits par la loi (tandis que d’autres bien légaux sont 100% dangereux pour la santé à long terme) et ce n’est pas le timide retour de la médecine psychédélique qui va changer ça de sitôt. Si les psychédéliques t’intéressent, tu peux télécharger le Manuel de réduction des risques que leur a dédié la Société psychédélique française.
Attention : tenter d’arrêter d’un coup vos consommations alors que jusque-là elles vous aidaient à faire face (même de manière inconsciente) peut être dangereux. Cela risque de perturber le mode de fonctionnement qui vous aidait à tenir. Les changements doivent être anticipés et réfléchis pour qu’ils se passent au mieux.
Des ressources et des pistes de soin
Pour faire face à un vécu traumatique, il existe par ailleurs de nombreuses thérapies (bien que les thérapeutes manquent cruellement face à la demande) et alternatives communautaires pour aider à soulager la douleur. La thérapie cognitive et comportementale (TCC) et l’EMDR sont par exemple de plus en plus utilisées et pratiquées :
« La thérapie cognitivo–comportementale ou TCC est une thérapie qui s’appuie sur des protocoles différents dont ceux de désensibilisation progressive aux stimuli dans un contexte de troubles anxieux et de phobies, d’origine traumatique.
L’« Eye Movement Desensitization and Reprocessing » ou EMDR est une thérapie brève qui a pour objectif le retraitement d’expériences traumatiques non intégrées, responsables de multiples symptômes, parfois très invalidants. Cette technique peut aussi désensibiliser aux stress et émotions en lien avec le traumatisme. On peut ainsi traiter et soigner des symptômes de stress post-traumatiques de nombreuses années après l’événement. »
S’appuyer sur l’entourage et les dispositifs existants
L’entourage peut aussi se révéler d’un secours certain (les personnes entourées se remettent mieux d’évènements traumatiques). Évidemment, on ne s’improvise pas psychologue en un claquement de doigts, mais mettre des mots sur des choses incomprises, trouver un espace de parole sécuritaire, empathique, bienveillant et sans jugement permet de travailler sur ces traumas.
Le dispositif Mon soutien psy permet quant à lui de bénéficier de 12 séances, présentiel ou téléconsultation, d’accompagnement psychologique chez un psychologue partenaire. Elles sont partiellement remboursées par l’Assurance maladie donc la séance revient à 20€. Cette démarche s’adresse à toute personne, dès 3 ans, qui se sent angoissée, déprimée ou éprouve un mal-être. Vous trouverez les psychologues partenaires près de chez vous sur carte interactive disponible sur le sitei.
Attention toutefois à ne pas forcer la parole par envie de bien faire. Des lignes d’écoute, des cercles de parole en non-mixité ou pas, des rencontres en réel avec d’autres personnes souffrant ou ayant souffert des mêmes troubles existent et valent aussi la peine d’être mobilisés.
Bibliographie :
« L’enfant victime d’un traumatisme », Isabelle Gravillon, L’école des parents n°627, 2018.
« L’urgence d’accueillir », Florence Askenazy, L’école des parents n°627, 2018.
« Chronologie des actes terroristes du XXIe siècle en France », Wikipédia
« Chacun sa blessure », Hélène Romano, L’école des parents n°627, 2018.
« La santé des élèves LGBTI », Johanna Dagorn et Arnaud Alessandrin, L’école des parents n°627, 2018.
« Influence de l’attachement et des psychotraumatismes dans les addictions aux drogues », Annales médico-psychologiques, Revue psychiatrique, volume 180, Issue 6, Supplement, 2022
« Comprendre, identifier, accompagner la pathologie duelle TSPT-TUS », Fédération Addiction, 2025
« Les consommations à risque chez les jeunes : facteurs de protection et de vulnérabilité », La santé en action, n°429, 2014