
Entre outil du quotidien et passerelle vers tous les excès, le smartphone occupe une place centrale dans nos vies. Mais que change-t-il dans notre rapport aux drogues ? Disponibilité permanente, nouvelles pratiques sociales, marketing de dealers 2.0… Les usages se transforment, et les risques aussi. La dépendance n’est pas qu’une affaire de substances psychoactives ! Quelle est l’influence des smartphones sur la consommation de drogues et les tendances addictives ?
💡 3 points pour mieux comprendre et prévenir
- Le smartphone amplifie nos usages… pas seulement nos messages.
Ce n’est pas l’écran qui rend accro, mais ce qu’il met à portée de main : applis, notifications, produits, rencontres. Identifier ce qui nous attire ou nous stimule aide déjà à garder la main sur nos usages. - L’accès facile, c’est aussi des risques accrus.
Commander via un téléphone peut sembler plus simple et plus sûr, mais on perd souvent en contrôle : produits de qualité incertaine, surconsommation par facilité, isolement… Avant de cliquer, mieux vaut se poser la question du contexte et des limites. - Informer, partager, se protéger.
Que ce soit sur les applis de rencontre, les réseaux ou les plateformes de vente, mieux vaut savoir à quoi on s’expose. S’informer sur les produits, parler de ses pratiques, avoir du matériel propre et connaître les numéros d’aide, c’est déjà réduire les risques.
Entre le Nokia 3310 indestructible et le premier iPphone se sont écoulées seulement sept petites années. Depuis, les modèles de téléphone intelligent se suivent et se ressemblent. Aujourd’hui, on peut tout faire avec un smartphone – d’ailleurs 6 internautes sur 10 sont actuellement sur leur téléphone – dont les performances n’ont pas à rougir face à des PC parfois vieillissants. À une époque où tout est possible sur un écran LCD qui tient dans la main, on s’est demandé quels impacts pouvaient bien avoir les smartphones sur nos tendances addictives. Voici quelques hypothèses.
Accro aux écrans ?
Déjà, quand on parle d’addiction et de téléphone, difficile de ne pas penser à l’addiction aux écrans. Alors qu’on se le dise : on n’est pas addict aux écrans en eux-mêmes, mais à ce qu’on consomme dessus. Tout est toujours une affaire de neurotransmetteurs, de dopamine et de circuit de la récompense… Comment des shots de plaisir parviennent à dérégler la chimie de notre cerveau. Nous ne sommes pas des moustiques attirés par la lumière. La formule « addiction aux écrans » est donc trompeuse.
Selon la synthèse des connaissances sur les addictions comportementales dressée par l’Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT), « Le mot écran, comme objet d’usage problématique, apparaît très peu dans la littérature scientifique concernant les addictions, au profit de tous les termes qui désignent les activités accessibles par Internet. Celles-ci peuvent être qualifiées d’addictives, dans le sens où elles ont pour point commun de capter et de retenir l’utilisateur, et donc de favoriser des temps d’usage prolongés ».
En dépit de ça effectivement, cette addiction comportementale peut provoquer des désordres, notamment chez les enfants et adolescents. Le temps passé (volé) devant des écrans peut l’être au détriment d’autres activités « nécessaires au développement cognitif, au sommeil, à l’exercice physique, à l’investissement scolaire… », et provoquer des effets négatifs sur la santé physique « fatigue oculaire, obésité… », détaille encore l’OFDT.
Faire ses traces sur son téléphone
Plus simplement, l’usage de drogue et les portables évoquent à coup sûr les traces qu’on fait sur son écran. C’est une surface lisse personnelle disponible en permanence. Même si… C’est une pratique qu’on déconseille fortement, votre smartphone étant sûrement la chose la plus sale que vous ayez sur vous : « Une enquête menée en 2019 au Royaume-Uni a révélé que la plupart d’entre nous utilisons nos téléphones aux toilettes. Il n’est donc pas surprenant de découvrir que des études ont montré que nos téléphones portables étaient plus sales que les sièges de toilettes eux-mêmes ! », rapporte en effet cet article.
D’autre part, c’est franchement grillé ! Avoir des résidus de poudre coincés dans les interstices, ça la fout mal. Selon les milieux dans lesquels vous évoluez, c’est plus ou moins discret. Une lingette alcool pour nettoyer son tel avant chaque trace semble être le minimum.
Livré à toute heure !
On appelle ça l’ubérisation. Vie-publique.fr définit le concept en ces termes : « La remise en question de structures économiques traditionnelles par la mise en relation directe des clients et des prestataires, via des plateformes numériques. » Avoir, grâce au smartphone et Internet, accès à une offre de services délirante. À commencer par les livreurs de drogues. Au détour de la crise Covid, l’offre s’est largement déployée sur l’ensemble du territoire, d’abord dans des grandes villes avant d’arriver dans des secteurs moins urbains (les Hautes–Alpes, la Corrèze, le Cher…).
Qu’est-ce que ça change aux habitudes de consommation ? Ça change qu’aujourd’hui, on peut, presque à n’importe quelle heure et n’importe où, accéder à de la drogue en livraison à domicile en une heure tout au plus. Finie l’époque où l’on devait se rendre au four, prévoir sa soirée en avance, faire un détour. Aujourd’hui, d’une minute à l’autre, il est possible de se faire livrer de la Drogue (avec un grand D) à domicile.
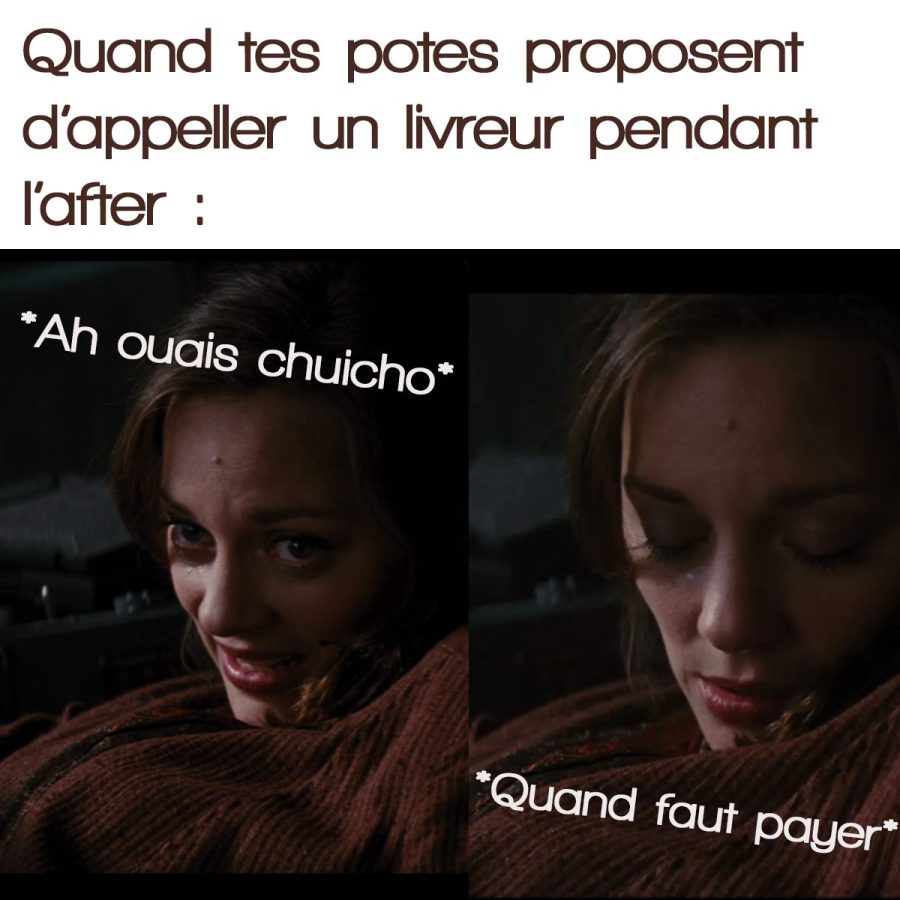
L’after s’éternise ?
Pas de problème, on appelle un livreur !
Plus de thunes pour ta conso ?
Pas de problème, on demande aux potes de se cotiser et on appelle quand même un livreur !
Avoir la possibilité permanente d’accéder au produit n’aide pas à la retenue. Ce qui n’aide pas non plus, ce sont les relances et les messages amicaux (voire carrément familiers) des numéros de dealers ainsi que leurs menus. De véritables cartes à rallonge, comme au restaurant, avec les produits, leur prix, et des infos marketing en plus. Provenance supposée, qualité et arguments de ventes tels que « shit triple filtré », « kétamine needle », « coke écaille de poisson », et autre « MD champagne », qui n’ont évidemment aucune valeur.

Sur ces menus, les tarifs sont évidemment dégressifs, poussant à la conso, et des offres sont parfois proposées comme « 2 grammes de c achetés, un taz offert ». Ces méthodes de vente agressives sont bêtement celles de la grande distribution et du marketing, et elles fonctionnent pour maximiser les profits.
Une incitation à l’usage ?
Il n’est même plus obligé d’être initié pour accéder aux services de livraisons. Sur les réseaux sociaux, on retrouve en pagaille des publications ou publicités à peine déguisées pour des drogues licites (alcool, tabac, snus, vapes) ou illicites. Et oui, les dealers aussi ont investi les espaces numériques ! Ils démarchent carrément sur Instagram et Snapchat. Cela pousse-t-il plus de gens à expérimenter davantage ? C’est bien possible. Surtout que le nombre d’expérimentateurs ne cesse d’augmenter, les rapports de l’OFDT sont très clairs à ce sujet .
Se rendre sur un point de deal est une expérience particulière. Sauter le pas demande bien plus d’implication que d’envoyer un texto à un numéro inconnu.
Mais ne nous limitons pas aux dealers issus des quartiers ! Nous ne sommes pas BFM TV !
Eh oui, sur Internet on peut acheter de la drogue. Pas besoin d’avoir accès au darknet. Des plateformes dont nous tairons le nom proposent des assortiments divers et variés de nouvelles drogues. Flirtant avec l’illégalité, la vente de ces NPS (nouveaux produits de synthèse) ou RC (Research Chemicals), selon comment on les appelle, se fait en un clic et les produits sont directement livrés dans nos boîtes aux lettres. Est-ce que cela rend La Poste complice de trafic de drogue ?
En outre, ces nouvelles substances de synthèse sont mises en vente sans qu’on ait aucune information sur leurs risques (durée, interactions, seuil d’OD, etc.), et sans aucun contrôle qualité (on le voit avec le 3-MMC vendue sur le Net qui n’est presque jamais de la 3-MMC mais d’autres cathinones de synthèse). Ce manque d’informations et la consommation à la maison (qui peut parfois se faire en secret et seul) peuvent avoir des conséquences dramatiques.
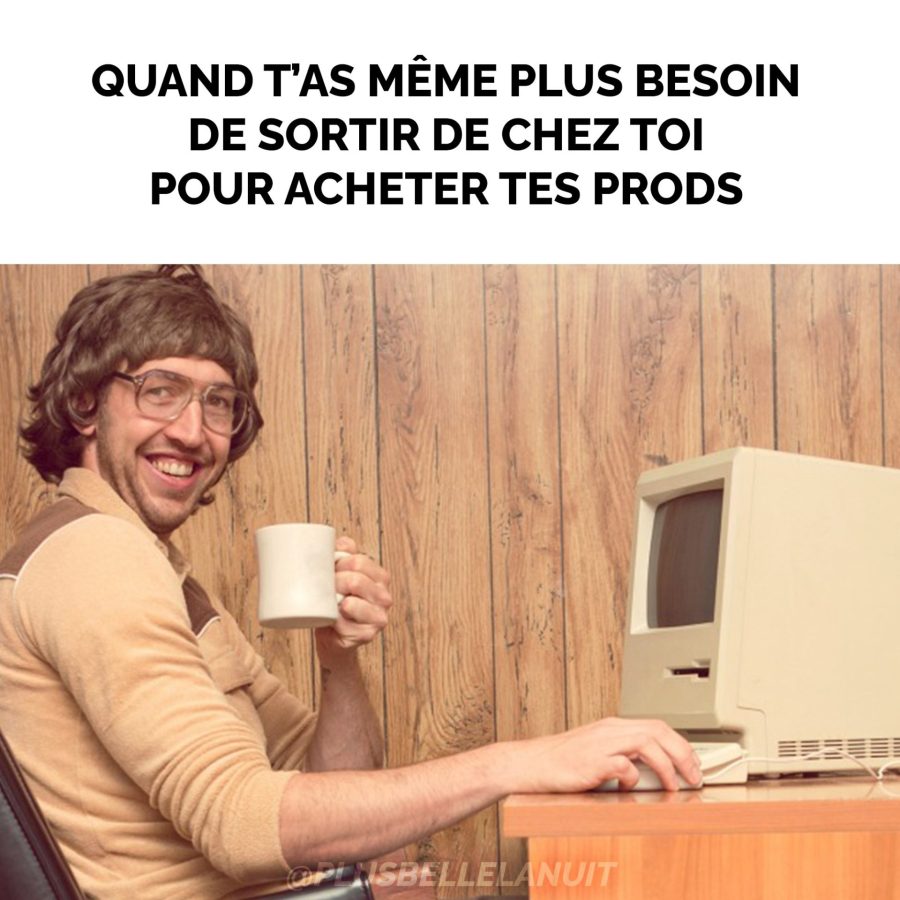
C’est sans parler des jeux en ligne (paris sportifs, poker, jeux d’argent ou de hasard), disponibles partout et tout le temps, qui peuvent entraîner une consommation compulsive et provoquer une dépendance. Ces espaces sont potentiellement nocifs pour la santé mentale et la santé tout court.
Plans planants
Impossible de parler de smartphone et d’usage de drogues sans parler des applications de dating. Notamment parce que ces applis sont indissociables du chemsex (qui est bien plus qu’une affaire de produits). Qu’il s’agisse de Grindr, Hornet, Scruff, Planète Roméo ou d’autres plus obscures, elles jouent toutes un rôle. À partir d’une certaine heure, le week–end sur les applis, on trouve plus de plans chems que de plans culs. Parfois étiquetés « plan planant », ces rencards posent des questions spécifiques qui concernent autant l’initiation douteuse à des pratiques que l’expérimentation de nouvelles drogues. Ces espaces sont loin d’être des safe spaces, les témoignages s’accumulent : se retrouver entre inconnus (parfois nombreux) dans un domicile privé alors que tout le monde est à poil et sous produit présente des risques.
Ainsi, le dating peut aussi se retrouver piégeux. On peut simplement vouloir faire du sexe mais embrayer sur une session conso de drogues. Piégeux, on a dit. Pour une communauté encore largement soumise à l’homophobie ambiante, les applis de rencontre sont parfois la seule manière de rencontrer d’autres LGBTQIA+. Mais la place que s’y sont faites les drogues rend leur usage périlleux. Posséder un téléphone moins performant, moins connecté est parfois un levier efficace pour lutter contre la dépendance.
Voilà. On arrive au bout de l’exercice. Cette liste de réflexions n’est évidemment pas exhaustive, et si vous souhaitez nous partager comment votre smartphone influe sur votre quotidien, n’hésitez pas à nous écrire à coucou@keps.app ou à laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux pour tout nous raconter.







