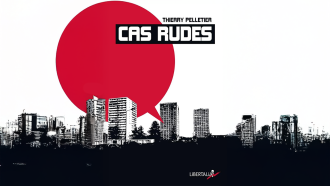Par une personne concernée – professionnel.le en réduction des risques
Chaque mois de septembre, la santé mentale est mise à l’honneur. Mais derrière les slogans et les campagnes, il reste un angle mort : celui des trajectoires où les troubles psychiques se croisent avec l’usage de substances, dans un va-et-vient silencieux entre survie et adaptation. Ces histoires, souvent invisibles, racontent ce que c’est que d’essayer de vivre avec un cerveau qui déborde, dans un monde qui exige de rester dans les lignes.
Dans cet article, j’ai voulu croiser deux regards : celui d’une personne concernée, et celui d’un·e professionnel·le de la réduction des risques. Parce que le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) adulte n’est ni une mode, ni une excuse. C’est un fonctionnement neurodéveloppemental spécifique, encore trop souvent mal compris, et qui peut conduire, faute de diagnostic ou de soins, à des usages de substances qui cherchent d’abord à apaiser. Et parfois, à tenir debout.
Vivre avec un trouble non nommé
Grandir sans savoir qu’on vit avec un TDAH, c’est souvent apprendre à se méfier de soi-même. Ne pas comprendre pourquoi on oublie, pourquoi on explose, pourquoi on décroche, pourquoi tout semble toujours trop ou pas assez. C’est se sentir en décalage, souvent, même quand tout semble fonctionner à l’extérieur.
En France, on estime que 2,5 à 5% des adultes vivraient avec un TDAH. Mais l’accès au diagnostic reste compliqué. Les délais en psychiatrie publique s’étendent parfois sur plus d’un an, et les consultations en libéral, quand elles existent, sont souvent inaccessibles financièrement. À cela s’ajoutent les biais : les hommes sont plus souvent diagnostiqués lorsqu’ils présentent de l’hyperactivité visible, tandis que les femmes sont fréquemment réduites à des troubles anxieux ou à une « grande émotivité ». Quant aux personnes en situation de précarité, leur parcours est souvent filtré par des grilles de lecture sociales, et le TDAH est confondu avec des troubles du comportement, voire des carences éducatives.
Alors on s’adapte. On compense. On s’épuise.
L’autodiagnostic : une révélation fragile
Un jour, entre deux vidéos ou dans un fil de discussion, on tombe sur un témoignage. Une description. Un mot. Et tout à coup, le puzzle prend forme. C’est parfois une immense libération : comprendre que ce qu’on vit porte un nom, que ce n’est pas une faute, ni une faiblesse, mais un fonctionnement cérébral différent.
Mais l’autodiagnostic, aussi nécessaire soit-il dans un premier temps, ne remplace pas une évaluation médicale. Et lorsque l’accès aux soins se fait attendre, ou qu’on a déjà connu des expériences déceptives avec le monde médical, le besoin de se soulager devient urgent. C’est là que commence, pour beaucoup, le recours à des substances comme tentative d’autorégulation.
L’automédication : bricolage à hauts risques
Dans mon cas, les substances sont arrivées avant le diagnostic. J’ai cherché à me calmer, à me concentrer, à dormir. J’ai pris ce qui était disponible autour de moi, sans toujours savoir ce que je faisais. Parfois ça m’aidait. Parfois ça empirait. Je touchais parfois le plaisir mais je consommais avant tout pour fonctionner la majeure partie du temps.
Ce que j’ai appris plus tard, c’est que les effets des substances psychoactives sur un cerveau avec TDAH peuvent être très spécifiques et souvent contre-productifs quand leur prise n’est pas encadrée. Le méthylphénidate, par exemple, peut être un traitement efficace sur prescription, mais utilisé sans suivi, il provoque de l’insomnie, de la nervosité, des pertes de contrôle émotionnel. La cocaïne donne un effet de concentration intense mais artificiel, suivi d’un crash difficile à gérer. Le cannabis calme à court terme, mais alourdit la pensée, ralentit les fonctions exécutives, et entretient souvent un cycle d’isolement et de perte de motivation.
Ce n’est pas anodin. Ce n’est jamais anodin. Et ce n’est pas rare. Le Dr Amine Benyamina, spécialiste en addictologie, rappelle que les adultes vivant avec un TDAH non traité ont un risque de développer un trouble lié à l’usage de substances jusqu’à trois fois plus élevé que la moyenne. Et ce risque augmente encore en cas d’anxiété, de parcours de vie instable ou de trauma.
Les trajectoires invisibles
Dans les lieux d’accueil, dans les bus, dans les salles d’attente, j’ai entendu des dizaines de récits similaires. Des jeunes qui prennent du méthylphénidate sans ordonnance ou des stimulants illicites pour tenir en cours ou au travail. Des adultes épuisé·es qui mélangent cannabis et anxiolytiques pour dormir. Des personnes qui ne comprennent pas pourquoi elles n’arrivent pas à faire comme les autres, et qui finissent par se sentir nulles, en plus d’être dépendantes.
Le plus souvent, personne ne leur a parlé de TDAH. On a parlé d’instabilité, d’addiction, d’échec scolaire, de marginalité. Et ces mots-là enferment plus qu’ils n’ouvrent.
L’accès au soin, enfin
Il m’a fallu du temps pour enfin chercher une réponse médicale. Et encore plus de temps pour être écouté·e. Mais le jour où j’ai eu un vrai bilan, un diagnostic posé avec sérieux, une proposition de soin adaptée, les choses ont commencé à changer. Le traitement n’a pas tout réglé. Mais il m’a permis de retrouver de la clarté. De mieux me comprendre. De reprendre la main sur mes choix. Et surtout, de ne plus avoir besoin de recourir à des produits pour apaiser ce que personne ne semblait voir.
Ce n’est pas miraculeux. C’est progressif, fragile, imparfait. Mais ça m’a redonné une forme de stabilité que je n’avais jamais connue.
La place de la réduction des risques
Travaillant moi-même dans la réduction des risques, je crois que nous avons un rôle essentiel à jouer pour mieux repérer, mieux orienter, mieux soutenir les personnes concernées par le TDAH. Cela commence par la formation des équipes, mais aussi par une posture d’écoute active et non jugeante. Il ne s’agit pas de poser des diagnostics à la volée, ni de médicaliser chaque situation. Il s’agit de créer des espaces où l’on peut poser des mots sur son vécu, envisager d’autres façons de faire, et retrouver du pouvoir d’agir.
Proposer de l’information sur les interactions entre substances et troubles de l’attention. Relier les acteurs du soin psychiatrique et ceux de l’addictologie. Coconstruire des outils avec les personnes concernées. Ce sont des leviers concrets, accessibles, qui peuvent transformer des parcours de vie.
Pour celles et ceux qui se cherchent encore
Si tu lis ces lignes et que tu te reconnais un peu, beaucoup, pas complètement mais quand même, sache ceci : tu n’es pas seul·e. Tu n’as pas à porter tout ça sans soutien. Tu as le droit d’avoir cherché des solutions. Tu as le droit d’avoir bricolé. Et tu as le droit, maintenant, de trouver une manière plus douce et plus sûre d’avancer avec ton cerveau.
Le TDAH n’est pas une tare. Ce n’est pas un mythe. C’est un fonctionnement différent. Et il mérite d’être compris, accompagné, respecté.
Pour aller plus loin
Wilens et al. (2008) – ADHD and Substance Use Disorders
Kaye et al. (2019) – ADHD and substance use disorders: An update
INSERM (2022) – TDAH adulte : prévalence, expression clinique et prise en charge
Benyamina, A. (2021) – TDAH et addictions : entre vulnérabilité et stratégies d’adaptation
tdah-adulte.org
addictaide.fr
tdah-france.fr